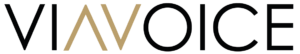Tribune de Philippe Leduc, journaliste et directeur du Think Tank Economie Santé – La crise sanitaire actuelle a surpris. Les prochaines, non. Car elles sont connues. L’explosion des pathologies chroniques et le tsunami du vieillissement constituent bien de nouvelles épidémies, certes non infectieuses. Pourtant les mesures nécessaires ne sont pas prises. Or la stratégie contre le Covid-19 ouvre de nouvelles perspectives qui pourraient se révéler fort utiles.
Vingt millions de Français souffrent d’une pathologie chronique. Rançon du progrès médical ou conséquence des périls climatiques ou des nouvelles habitudes occidentales de vie, ces affections au long cours ne cessent de progresser : diabète, cancer, hypertension artérielle, obésité, pathologies respiratoires, allergies, etc.
Le vieillissement de la population accentue cette évolution avec son propre cortège de difficultés : troubles locomoteurs, déclin cognitif, vulnérabilité, isolement, sédentarité. La pyramide des âges se transforme de plus en plus en toupie, le baby-boom se transformant en un papy-boom qui donne le vertige. Les 65 ans et plus sont passés de près de 8 millions (soit 14% de la population métropolitaine) en 1990 à 9,4 millions (16%) en 2000, 10,5 millions (16,8%) en 2010 et 13,5 millions (20,7%) en 2020. On voit l’accélération. Une augmentation de 75% en trente ans.
Repérer et accompagner
Ces évolutions sont bien connues. De même que les solutions : prévention, repérage, dépistage, prise en charge et accompagnement tant médical que social. Depuis vingt ans de nombreuses initiatives ou expérimentations ont été menées mais les résultats – aussi étonnant que cela puisse paraître – ne sont pas à la hauteur des enjeux, loin de là. Ce n’est pas par défaut d’ingéniosité ou de volontarisme de quelques-uns.
Quelques exemples. Chaque année, 9 000 diabétiques doivent subir une intervention d’amputation. Trop de personnes âgées, du fait d’un manque d’anticipation, se retrouvent hospitalisées en urgence ce qui les aggrave plus que cela ne les soulage. De même, le déclin cognitif et la maladie d’Alzheimer pourraient être réduits fortement par des mesures somme toute assez simples. De même pour nombre de pathologies.
Un fichier « Contact Covid »
Or, face à la sévérité de la pandémie actuelle de coronavirus, une mesure singulière vient d’être prise (article 6 de la loi Prolongement de l’état d’urgence sanitaire). Il s’agit justement de repérer et accompagner les personnes en danger pour elle-même et pour les autres en cassant la chaine de contamination.
Elle suscite de vives polémiques qui ne sont pas anodines : flicage, rupture du secret médical. Un médecin qui suspecte une infection Covid chez un patient l’inscrira dans le fichier « Contact Covid » électronique de l’Assurance maladie et commencera à chercher auprès de ce patient les éventuels contacts qu’il aurait eus et qui seront pris en charge par une brigade (drôle de nom) d’au moins 6 500 personnes. Ce fichier n’est qu’une extension mais colossale dans ses conséquences de ce qui existe déjà pour la déclaration des « affections de longue durée » (ALD) ou des maladies infectieuses comme la méningite justement dans le but de rechercher les éventuelles personnes contaminées.
Ce système d’information est créé, est-il indiqué dans la loi, qu’« aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid‑19 et pour la durée strictement nécessaire à cet objectif ». Un autre fichier (Sidep, service intégré de dépistage et de prévention) permettra de suivre et contrôler la réalisation et les résultats des tests virologiques.
Une société de surveillance liberticide ?
Est-on ainsi entré dans une Société de surveillance liberticide ou non ? Pour les médecins généralistes du syndicat majoritaire, il s’agit d’une « fierté et d’une reconnaissance de leur rôle d’acteurs de santé publique ». De même le Collège de la médecine générale martèle qu’« il s’agit bien d’une nécessité scientifique, humaine et éthique que de s’efforcer à prévenir les cas contacts de leur potentiel sur-risque infectieux ».
La loi précise que ce recueil de données médicales pourra se faire « le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées ». Mais ce Collège pointe que « tout médecin, fidèle à ses engagements déontologiques, s’efforcera de recueillir ce consentement pour chaque personne concernée ». Trois syndicats de médecins partagent cet avis : « L’obligation écrite par le parlement, si elle protège le professionnel, ne doit pas freiner la recherche d’un accord partagé entre le malade et son médecin sur la prise en charge de son affection. »
Pour les spécialistes d’un nouveau syndicat, le fait de lier la rémunération du praticien à « une inscription déclarative et nominative du patient sur une plateforme administrative pose des problèmes de secret médical, d’éthique pour le médecin et de respect du droit des patients ». L’Ordre des médecins revendique le rôle des médecins et souhaite que soit « écartée toute confusion entre cette finalité et la prise en charge médicale individuelle des personnes concernées qui reste assumée par les médecins et l’équipe de soins dans les conditions habituelles ».
Une première numérique
Des parlementaires se sont émus de ce système de fichage. Le ministre de la Santé a tenté de les rassurer. La Cnil a été auditionnée. Le directeur de l’Assurance maladie assure que « ces instruments sont très classiques, mais vu le nombre important de cas Covid il fallait adapter l’organisation ». Ces débats sont importants car la vigilance doit être vigoureuse.
Il est vrai que cette démarche est une première en France. Numérique et anticipatrice. Numérique, car c’est la première fois qu’un fichier est utilisé à une telle échelle pour signaler et agir, en bonne intelligence avec les soignants. Anticipatrice, car elle permet d’agir avant l’arrivée des symptômes et de ne pas attendre la constitution d’une maladie pour la détecter et proposer un accompagnement.
Une révolution culturelle
La crise sanitaire du siècle a ainsi ouvert une voie vers une nouvelle manière d’aborder une maladie, plus horizontale, participative, impliquante et contrôlée. Peut-on imaginer un tel système pour les pathologies chroniques et celles du vieillissement ? Certes non !
Mais cette initiative volontariste ne doit-elle pas inciter à la réflexion. Pour de nombreuses raisons. Ne plus subir mais anticiper. Ne plus traiter qu’une partie du problème mais avoir une vue globale. Ne plus s’accommoder des inégalités de santé mais cibler les actions. Ne plus se cantonner à l’individu mais au collectif, à une population. Et enfin pour le soignant ne plus agir encore trop souvent isolément mais en coordonnant ses efforts avec les autres.
Il s’agit là subrepticement d’une vraie révolution culturelle. Même si déjà bon nombre de professionnels de santé agissent de cette manière mais ils manquent de moyens et d’organisation.
Inventer la médecine du XXIème siècle
Pourtant nombre d’outils ont été développés au cours des dernières années : les équipes de soins primaires (ESP), les collectifs de professionnels de santé sur un territoire (CPTS), les plateformes territoriales d’appui (PTA), les Clic (Centres locaux d’information et de coordination), les Maia (Action, intégration, autonomie) sans oublier les expérimentations PAERPA (personnes âgées en risque de perte d’autonomie). Mais tout cet arsenal de dispositifs manque cruellement de connexion et de cohérence.
La période de refondation qui va s’ouvrir est propice – par le choc subi – pour inventer la médecine du XXIème siècle qui justement doit davantage s’appuyer sur le repérage et l’accompagnement, dans le respect de la liberté individuelle. Déjà, après la canicule de 2003, un premier pas avait été franchi avec le repérage et la protection des personnes âgées isolées, mais trop limité et mal appliqué.
Cette tribune a été initialement publiée sur le blog du Think tank Economie Santé
Lire les épisodes précédents :
- L’après COVID-19, épisode 1 : quel système de soin après le virus ?
- L’après COVID-19, épisode 2 : l’hôpital a la clé de sa refondation
- L’après COVID-19, épisode 3 : les libéraux de santé au front, mais quel front
- L’après COVID-19, épisode 4 : le patient dans le nouveau système de santé
- L’après COVID-19, épisode 5 : l’État et la Santé, pour une refondation
- L’après COVID-19, épisode 6 : le fol espoir du numérique en santé
- L’après COVID-19, épisode 7 : financer la santé, c’est choisir