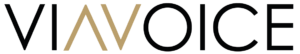La douleur, on en parle, on acquiesce poliment sur la nécessité de la prendre en charge… mais cela reste très inégal en fonction de l’établissement, de la formation du personnel, et de l’ouverture d’esprit des équipes sur les techniques complémentaires. Recherche, formation, sensibilisation, financement des actions : il y a beaucoup à faire pour réduire l’écart entre l’attente des patients sur le sujet et sa réelle prise en compte par tous les acteurs de notre système de santé. Interview avec Nathalie Aulnette, directrice de la Fondation Apicil, qui a fait de ce combat le cœur de son action.
Propos recueillis par Renaud Degas avec Maellie Vezien
Comment la douleur est-elle prise en charge par les acteurs de la santé, selon vous ?
Nathalie Aulnette : D’un point de vue sociétal, il y a un décalage entre les attentes des patients, qui sont de plus en plus importantes, et la réalité du terrain. Pour les patients, c’est une vraie priorité de ne pas avoir mal, alors que la prise en charge de la douleur n’en est pas une pour les autorités. Elle n’est d’ailleurs toujours pas reconnue comme une spécialité médicale.
La prise en charge est donc très inégale en fonction de l’établissement, de la formation du personnel, et de l’ouverture d’esprit sur les techniques complémentaires et sur une médecine plus intégrative. Dans certains secteurs, notamment dans la prise en charge des patients âgés, c’est encore plus désolant, car la plupart des intervenants ne sont pas du tout formés à la gestion de la douleur, pourtant omniprésente chez ces patients.
L’enjeu actuel, c’est de mettre le sujet en haut des préoccupations pour qu’il soit pris en compte par les autorités, mais également par les équipes de soins. Ensuite, il faut vraiment maximiser la formation des équipes, puis diffuser les solutions qui fonctionnent. Une formation à la douleur devrait être obligatoirement dispensée pour savoir qui prévenir et comment agir face à un patient douloureux.
Pour vous, la douleur doit-elle être prise en charge par les techniques complémentaires plutôt que par la médication ?
N.A : La douleur est définie par une sensation et une émotion. Donc, à la Fondation, nous pensons qu’une articulation entre les deux types de prise en charge est indispensable dans le cadre de la douleur chronique.
L’innovation médicamenteuse est fondamentale pour améliorer la prise en charge de la douleur, mais toute la dimension psychosociale d’un individu (mode de vie, besoins, capacités à réagir et à mobiliser des ressources…) ainsi que l’aspect émotionnel, qui est connu comme un amplificateur du ressenti douloureux, le sont également. Cependant, ils sont insuffisamment pris en compte.
On constate que c’est une attente très forte des patients et que de plus en plus de professionnels de santé s’y intéressent. Malheureusement il n’y a pas de prise en charge par la Sécurité sociale la plupart du temps.
Quel est le rôle de votre fondation et vos leviers d’action ?
N.A : Notre rôle principal est d’accompagner les professionnels de santé, qu’ils soient chercheurs ou médecins, afin de faire émerger les besoins du terrain et de les encourager dans la création de projets sur le sujet de la douleur. Ensuite, nous mettons en place des projets dans des structures hospitalières et des lieux d’accueil pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Nous avons pour mission d’accueillir tous les projets : il n’y a pas de petit ou grand projet, il n’y a que des projets intéressants !
Nous avons aussi pour mission de donner de la visibilité à la douleur et à sa prise en charge. Nous informons donc beaucoup à travers des films, communiqués de presse, photos, articles, participations à des congrès et interviews. Nous avons vraiment la volonté de sensibiliser les acteurs au fait que ce sujet devrait devenir une priorité.
Enfin, nous soutenons également des associations de patients ou d’autres fondations avec lesquelles nous avons des partenariats pour la remise de prix en lien avec la prise en charge de la douleur.
Quels sont les types de projets que vous financez ?
N.A : La moitié des projets que nous accompagnons concernent la recherche clinique, aussi bien sur les traitements et les prises en charge conventionnelles que sur les approches complémentaires, ce qui est assez original dans le domaine. Par exemple, nous avons financé un projet de recherche avec le Dr Guillaume Buiret pour démontrer que la présence d’une socio-esthéticienne dans son service d’oncologie permet d’améliorer l’état anxieux des patients et de diminuer la consommation médicamenteuse.
Nous accompagnons également des projets autour de la dépression post-partum et sur des questions très variées, comme, par exemple, « La musique peut-elle soulager les femmes fibromyalgiques ? ».
Nous investissons beaucoup dans des projets pilotes qui permettent de tester une idée avant que le projet définitif soit mis en place. De cette façon, la Fondation permet d’établir certaines preuves de concept pour qu’elles soient ensuite diffusées à plus grande échelle.
Sur un autre plan, nous finançons aussi des postes d’art-thérapeutes, de socio-esthéticiennes, de personnes qui travaillent la terre, ou encore de bibliographes hospitaliers, qui ont un rôle important pour l’accompagnement des patients ayant besoin de temps et d’écoute.
Une partie de notre financement est également dédiée aux formations sur les techniques complémentaires déjà validées : la sophrologie, la relaxation, l’hypnose, l’acupuncture ou l’auriculothérapie.
Enfin, nous finançons de l’aide à la communication : des congrès, des journées d’information, des fiches informatives ou des carnets de liaison pour faciliter la communication entre enfants et parents. Les idées qui fonctionnent sont ainsi transmises à d’autres praticiens, qui peuvent alors s’en inspirer.
Essaimer et pérenniser sont nos mots-clés pour nos choix de projets !
Prix Fondation Apicil–SFETD 2025
Candidature jusqu’au 28 avril 2025.
« Innovations physiopathologiques, diagnostiques et thérapeutiques ». En partenariat avec la SFETD, la Fondation APICIL attribue le Prix SFETD/ Fondation APICIL « Innovations physiopathologiques, diagnostiques et thérapeutiques au service des patients douloureux » d’un montant de 15 000 euros pour permettre à un professionnel de santé (médical ou paramédical), un jeune chercheur scientifique en cours de thèse ou en stage postdoctoral, de réaliser, poursuivre ou achever un projet de recherche dans le domaine de la douleur. En savoir plus.
Appel à projet Santé mentale
La Fondation APICIL proposera prochainement un appel à projets orienté sur la santé mentale. Ce sujet est en lien avec la grande cause nationale 2025. Cet appel à projets courra sur la période 2025-2026. Un jury de 16 experts de la santé mentale étudiera les projets qui parviendront de toute la France à la Fondation APICIL.