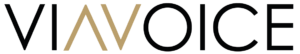À l’occasion des 20 ans de l’entrée en vigueur de la loi Kouchner, la Fédération Diversité Proximité Mutualiste (FDPM) a réuni, le 10 mai, des acteurs de la mutualité, de l’éthique, du sanitaire et du médico-social pour évoquer les défis qu’il reste à relever en matière de démocratie en santé*. Un moment placé sous le parrainage de Stéphane Viry, député (LR) au sein de la première circonscription des Vosges. Jean-Louis Span, Président de la FDPM, en tire plusieurs enseignements, parmi lesquels : la nécessité de penser en terme de démocratie en santé de proximité et le rôle clé que peut jouer la Mutualité en la matière.
Vingt ans après la loi Kouchner du 4 mars 2022, où en est-on concrètement en matière de démocratie en santé de proximité ?

Jean-Louis Span (JLS) : 20 ans après, il est remarquable que les principes essaimés depuis avec, notamment, le libre choix, la participation et le consentement ont été investis, pensés, et intégrés au sein des démarches institutionnelles.
Ils se sont matérialisées au travers de nombreux outils réglementaires : Conseil de la vie sociale (CVS), représentants d’usagers et tant d’autres …
Si bien, que les personnes ont parfois pu se perdre dans la compréhension de toutes ces instances.
C’est pourquoi, au niveau de la FDPM et des petites et moyennes mutuelles (PMM), les adhérents ont exprimé le besoin de disposer d’un Guide Mutualiste de la Démocratie en santé afin de les identifier.
Ainsi, notre effort d’explication a été réel et doit être poursuivi.
Quels aspects positifs peuvent être salués ?
JLS : D’abord, l’ambition d’une généralisation participative est tout à fait remarquable. En effet, sous l’effet de diverses mesures législatives, celle-ci est désormais ancrée au cœur du pilotage de toutes les instances sociales, médico-sociales et sanitaires.
On peut, également, se réjouir de la généralisation de l’appellation démocratie en santé. Elle témoigne d’une vision de la participation, du consentement et du libre choix émancipée d’une stricte approche sanitaire pour rayonner sur la santé dans sa globalité et au plus près des territoires.
Un des autres aspects positifs que je retiens est celui d’une réflexion engagée autour des conditions de la participation.
En début de séminaire, nous avons voulu illustrer cet aspect à travers la restitution de l’expérience mutualiste participative de démocratie en santé faite par la FDPM durant l’année 2020.
Matérialisée par la construction d’un questionnaire articulé autour des thématiques suivantes: “besoin, parcours et financement de la santé”. Les questions qui en ont découlées, tout comme les modalités de diffusion, ont été co-construites sur les territoires, par les adhérents et avec les partenaires des petites et moyennes mutuelles adhérentes à la FDPM.
Il en a résulté une diffusion papier et en ligne, entre septembre 2021 et janvier 2022, qui donnera la parole à 643 répondants.
Cette initiative nous a, ainsi, renvoyée à des enjeux de méthodes forts qui ont permis d’améliorer notre pratique participative.
En effet, nous avons constaté que le bon déroulement d’une telle démarche repose sur “3 ingrédients” indispensables à la réussite d’une action locale de promotion, d’éducation et de prévention en santé : la prise en considération de l’expérience de la personne nécessairement articulée à une dualité pédagogique et sous-tendue par une approche éthique rigoureuse.
Je m’explique ! La démocratie en santé de proximité vise à aller chercher des personnes éloignées de la santé pour des raisons diverses et variées.
Lorsque ces personnes sont identifiées, notre responsabilité première est de les écouter, de comprendre et d’évaluer les raisons qui justifient cet éloignement de la santé. Sur cette base, nous pouvons alors exposer et expliquer de possibles solutions qu’il s’agira, ensuite, de co-construire.
Ce partage d’information entre usager et professionnel conditionne la réussite de l’exercice démocratique. Et c’est la raison pour laquelle je parle de “dualité pédagogique“.
Tout au long de cette relation, l’approche éthique est essentielle car elle permet de personnaliser l’accès au droit des personnes en tenant compte de leur expérience, de leur niveau de confiance et de leur capacité d’engagement.
Cela élargit considérablement la dimension participative appréhendée sous le seul angle du rapport singulier patient-médecin. Elle témoigne d’une évolution de paradigme glissant du “Agir au service de la personne” vers “Agir avec la personne” afin de produire un service de santé des plus pertinents, à savoir, celui qui sera adapté à ses besoins !
A mon sens, cette approche est particulièrement positive car elle constitue une alternative sérieuse à la marchandisation des services de santé.
A contrario, sur quels aspects la France pourrait-elle faire des progrès ?
JLS : A ce jour, avec tous les acteurs de santé, nous partageons le constat que les modalités de la représentation et de mise en œuvre de la démocratie en santé de proximité posent au moins 7 enjeux majeurs :
– Penser en terme de démocratie en santé de proximité. La notion de proximité est essentielle. C’est la raison pour laquelle toutes nos communications l’invoquent. C’est dans le rapprochement avec les citoyens et les instances dédiées telles que les Conseils de Citoyens et de Quartiers, les Conférences Régionales de Solidarité et d’Autonomie, les Conférences Territoriales de Santé et les Espaces de Régionaux de Réflexion Éthique qu’elle peut et doit se cultiver.
– Co-construire des creusets institutionnels adaptés à la proximité et mettant la personne au cœur de l‘action local de santé
– Apprendre à considérer la personne en tant qu’acteur de santé responsable et autonome afin, ensuite, de cultiver une démarche d’engagement
– Développer et promouvoir une approche inclusive afin d’organiser la rencontre participative avec les personnes les plus éloignées de la Santé
– Intégrer l’altérité en partant d’une considération pleine et entière de la compréhension et de l’expérience citoyenne
– Sortir d’une logique en silos pour promouvoir le “faire-ensemble” sur les territoires de vie
– Introduire un principe de reddition des comptes, comme cela se fait en matière environnementale, où toutes les propositions émises dans le cadre d’une démarche participative doivent faire l’objet d’un argumentaire motivant les raisons pour lesquelles elles ont été retenues ou pas.
Quel rôle joue ou peut jouer la Mutualité sur ce point ?
JLS : La seconde partie du séminaire a permis de réfléchir à la place à tenir par la Mutualité pour accompagner l’épanouissement de la démocratie en santé de proximité.
Et, effectivement, les participants ont partagé leurs sentiments sur le fait que la Mutualité devenait un partenaire pertinent en raison des quelques atouts suivants identifiés :
– Elle bénéficie d’une proximité avec les citoyens
– Elle favorise les conditions d’exercice de la démocratie en santé par un apport pédagogique** permettant de prendre en compte, de soutenir et d’accompagner l’expérience citoyenne
– Elle a développé une agilité lui permettant de capter tous les acteurs de l’action locale de santé
– Elle est en capacité de procéder à une analyse fine des besoins en santé propre aux territoires
– Elle est engagée, pour ne parler que des PMM de la FDPM, sur un principe de garantie de reddition des comptes.
Face à chaque décision prise, nous devons argumenter en toute transparence sur les choix opérés et les alternatives laissées de côté.
Dans ce cadre, des actions communes ou des partenariats sont-ils envisageables entre fédérations de mutuelles ?
JLS : En sortie de séminaire, le premier constat partagé avec les acteurs mutualistes a été celui de la responsabilité qu’il nous incombe en matière de démocratie en santé de proximité. Depuis que nous existons, notre propension à l’innovation et notre souci de l’efficience ont toujours su faire évoluer notre raison d’être.
Bien qu’à l’issue de cette journée nous n’ayons pas acté des engagements de partenariats clairs, il est évident que nos démarches respectives révèlent une approche commune et une volonté partagée de remettre la personne au cœur du dispositif participatif, autant dans les établissements qu’au domicile.
Notes :
*Cette journée fut successivement animée, le matin, par Karine LEFEUVRE, vice-présidente du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) et personne qualifiée en matière de démocratie en santé et, l’après-midi, par Delphine HOURDEBAIGT, Cheffe de projet et ingénierie santé à la FDPM, particulièrement investie dans les problématiques liées aux besoins de santé et à l’évolution de la valeur des services mutualistes.
**Dans son Manifeste Mutualiste de la Démocratie en Santé, la FDPM défend et caractérise la pédagogie mutualiste à travers ces 5 axes : “ Informer, former, participer, concerter et délibérer”.
Pour aller plus loin
- La démocratie sanitaire en France 20 ans après la loi Patients : Trois questions à Gérard Raymond (Institut Montaigne)
- Réinventer la démocratie en santé – retour sur les 20 ans de la loi « droits des malades » (Espace Ethique Région Ile de France)
- Loi Kouchner : vingt ans après sa promulgation, patients comme médecins appellent de leurs vœux une meilleure connaissance de celle-ci (Rapport de l’Ordre des médecins)
- Démocratie en santé : 20 ans après le vote de la Loi Kouchner, quel bilan ? (Ligue contre le cancer)
- La démocratie en santé fête ses 20 ans : le temps de la refondation ? (The Conversation)