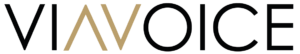Synthèse par Alexandre Terrini – Les Contrepoints de la santé du 18 janvier 2018, organisés par Pascal Maurel, Philippe Leduc et Renaud Degas, avaient pour thème les données de santé et leurs enjeux. Dominique Polton, Présidente de l’Institut national des données de santé (INDS), et Gwendoline Boyaval, Directrice accès au marché du laboratoire MSD, ont toutes deux appelé de leurs vœux un interventionnisme plus grand des pouvoirs publics pour dégager une stratégie à la hauteur des potentialités et des périls que recèle cette matière première pas comme les autres.
Intégrale et temps forts en vidéo
Sondage BVA
Nul n’en disconvient et plus personne ne l’ignore : comme l’a rappelé Dominique Polton, les données de santé sont source de « bénéfices de toutes sortes, pour les patients afin que l’on puisse personnaliser leurs traitements et leur accompagnement ; pour les professionnels qui peuvent ainsi avoir accès à l’expertise et avoir une regard plus aiguisé sur le système ; enfin, pour la recherche quand bien même les données observationnelles qui sont mobilisées ne le sont pas autant qu’elles pourraient l’être alors que les modèles de recherche ont changé. »
Un bilan en clair-obscur
En matière de données de santé, la France affiche un bilan en clair-obscur. Elle a « la chance, a affirmé la Présidente de l’INDS, d’avoir 67 millions de données médico-administratives dans une base sans personnes perdues de vue et codées de manière relativement homogène. C’est un gros avantage qui n’est pas inintéressant dans la compétition internationale. » Et qu’il convient de faire fructifier dans les plus brefs délais. Ce qui est encore loin d’être franchement le cas. « Il faut que l’on se bouge et que l’État donne une stratégie, un élan, une impulsion », a demandé Dominique Polton même si « c’est l’affaire de tous, des cliniciens comme des industriels qui peuvent être partenaires dans la coconstruction d’outils de ce type. » Encore faut-il, pour cela, que ces derniers jouent le jeu et soient un peu partageurs, quitte à y être contraints par les tutelles. « L’enjeu, dans le futur, est la coconstruction de bases », a insisté la patronne l’INDS pour laquelle il y a « un problème de gouvernance de la donnée collectée par les uns et les autres » dans la mesure où chacun se comporte comme s’il en était le propriétaire exclusif.
« On peut faire confiance aux industriels de santé »
Faux, lui a répondu, en substance, Gwendoline Boyaval : « On partage nos données au cours des discussions avec les autorités de santé. » Et la Directrice accès au marché du laboratoire pharmaceutique MSD de plaider pour sa paroisse quand il s’est agi de garantir la probité de sa profession en matière d’utilisation des données de santé : « On peut faire confiance aux industriels de santé dans la génération des données. En ce qui nous concerne, nous sommes une industrie très encadrée qui a pris ses précautions pour éviter les dérives, en particulier, le consentement des patients et le fait que les données soient anonymisées. »
Et si les laboratoires ont déjà pris langue avec les Gafa, promis, juré, tout se fera dans les règles de l’art : « Nous allons de plus en plus travailler avec ces acteurs car ils ont une expérience complémentaire en termes de données non structurées et de mise en place d’algorithmes pour profiler les patients. En revanche, nous ne leur ouvrirons pas nos données. En outre, il faudra s’assurer, par exemple en prévoyant dans nos contrats de partenariat la possibilité d’effectuer des audits, qu’ils respectent bien la nouvelle réglementation européenne. »
Dans ce contexte, cette dernière, qui sera effective dans l’Hexagone dès cette année, est perçue comme un précieux garde-fou en même temps qu’une évolution opportune dans la mesure où ses deux principaux leitmotivs sont un renforcement de la responsabilité des personnes en charge des traitements des données, avec, à la clef, des sanctions accrues, mais aussi une simplification et un allègement des procédures requises. De quoi, dixit, Dominique Polton, assurer « une coordination plus forte et une régulation européenne à la fois plus crédible et plus unifiée ».
Où va-ton ?
Reste à savoir où l’on veut aller. Or, c’est précisément là que le bât blesse, comme l’a déploré Gwendoline Boyaval. A ses yeux, il est urgent de « fixer un cadre et des priorités pour savoir où l’on doit investir de manière massive et quelles sont les aires prioritaires en matière de génération de données. Ce qui implique une collaboration très en amont entre les différents acteurs pour définir ce que sont l’usage et la valeur de ces données. » Autre nécessité : « valoriser la nouvelle génération de données que l’on génère aujourd’hui et qui complètent les données cliniques ». Comment ? En « prenant en compte, quand on est en discussion avec les payeurs ou les autorités qui font des recommandations en matière de remboursement, leur apport aux stratégies thérapeutiques et les économies qu’elles génèrent ». En somme, il convient de « reconnaître les investissements des différents acteurs de la santé » dans ce dossier. Le discours a le mérite d’être clair…
Enfin, cette formalisation « d’une vision stratégique de la donnée par les pouvoir publics » est le préalable à la création d’une « filière d’activité axée autour de la génération de la donnée, pourvoyeuse d’emplois qualifiés et qui permettra d’aider au pilotage d’une politique de santé mais aussi de définir des indicateurs de qualité en termes de suivi et de pertinence des soins ».
Les Français oscillent entre intérêt prononcé et méfiance
Et ce, à l’heure où, d’après un récent sondage BVA, les Français oscillent entre un intérêt prononcé et une méfiance à l’égard des données de santé. Ainsi, 60 % d’entre eux pensent que l’apport du big data est positif et qu’il vaut mieux être pris en charge dans un établissement qui a accès à des bases de données de cas patients au niveau international ; 98 % sont prêts à partager de leurs données de santé connectées avec leur médecin traitant et l’ensemble des acteurs de santé y compris l’Assurance maladie et laboratoires de ville ; 51 % estiment que les objets connectés peuvent être utiles pour prendre en main leur santé. En revanche, 67 % n’ont pas confiance dans les applications et les objets connectés en raison du piratage des données et 99 % refusent de partager leurs données avec les Gafa.
Des chiffres qui traduisent la nécessité d’une politique volontariste pour que les données de santé ne servent pas à fabriquer un monstre qui se retournerait contre ceux qu’elles sont censées sauver.