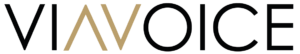Tribune – Par Dominique Maigne. La plus grande crise sanitaire de notre histoire moderne a remis « l’église au milieu du village » : la santé redevient une fonction collective de premier rang, là où elle n’était plus qu’une fonction de coût. Ne gâchons pas ce moment !*
La mobilisation exceptionnelle des professionnels de santé exige de la part des gouvernants une sortie à la hauteur de leur engagement.
Mais les questions de l’avant crise reviendront dans l’après et le chemin de rédemption des gouvernants de l’avant ne passera pas nécessairement par les solutions de leurs opposants.
Rien ne sera plus comme avant !
Faire résipiscence oui peut-être, mais pas sur l’autel d’un néo-libéralisme sanitaire qui n’existait que dans les phantasmes des idéologues de la gauche radicale et du syndicalisme dit de classe. La France fait partie du groupe de tête des pays industrialisés par la proportion du PIB consacré à la santé (11%), et l’un des plus socialisés : près des trois quarts de la consommation de santé est garantie par l’Assurance maladie et le taux de croissance des dépenses se situe dans le standard européen.
Vouloir inscrire dans les règles d’or budgétaires qu’il est interdit de faire des économies dans le champ de la santé est une ineptie. Sauf à considérer, comme Claude Evin l’a rappelé, qu’il convient d’assortir cette règle d’une hausse automatique des impôts et cotisations.
La régulation, rempart de l’Etat sanitaire solidaire
La régulation des dépenses, c’est-à-dire leur rationnement pour parler clair, sont les marqueurs principaux et obligatoires d’un régime de protection sociale solidaire.
Accumuler les dépenses, en laissant filer les restes à charge, assure encore plus d’inégalités d’accès et de traitement, sans garantie d’une meilleure qualité des services rendus.
Les restructurations hospitalières sont nécessaires
Faut-il continuer la politique de restructuration de l’offre hospitalière qui est le levier privilégié de maîtrise des coûts ?
L’urgence et la décence est de mettre de côté des plans d’économies, non compris par l’opinion et jugés technocratiques, qui demandent à être réévalués et réinvestis par le champ politique.
La contraction du parc hospitalier public et privé, à l’aune de l’ambulatoire, est une évidence qu’il faut poursuivre car elle peut concilier des gains de productivité à redistribuer dans le système avec une qualité et sécurité des soins accrues. Mais les organisations ambulatoires, autonomisées et décloisonnées en plateaux transversaux, consomment autant voire plus de personnel soignant. Il faut donc arrêter de financer des investissements de développement par des suppressions de postes soignants.
C’est là la principale critique que l’on peut adresser au système de régulation des coûts hospitaliers, les fameux Copermo, qui ont cru trouver la martingale unique au financement des investissements hospitaliers publics.
Organiser le parc hospitalier en filières
La contrepartie, c’est qu’il faudra continuer à fermer des lits, sans aggraver la fracture territoriale. La réponse se trouve certainement dans les groupements hospitaliers qui sont une mise sous filière intégrée de tous les hôpitaux d’un territoire homogène. Il faut accélérer l’intégration des GHT dans des entités opérationnelles et, pour cela, les fusionner dans une seule entité gestionnaire. La révision de la carte des GHT est aussi nécessaire, avec une interrogation sur des périmètres fonctionnels appropriables par les professionnels et les usagers.
La gouvernance d’entités qui doit s’appuyer sur un projet médical structuré et réparti sur un territoire populationnel large, suppose une médicalisation accrue du pilotage des établissements.
Crever l’abcès de la gouvernance en intégrant les médecins
Pour se faire, il faut crever l’abcès de la gouvernance en intégrant les médecins à la direction : un directeur médical de territoire en capacité de jouer sur les leviers des ressources soignantes du groupement.
Pour le secteur privé, l’enjeu est celui d’une mise en réseau de ses établissements en cohérence avec le projet régional de santé en donnant à leurs opérateurs une garantie d’égalité de traitement avec le public, par une véritable délégation de service public.
Une interrogation doit être portée sur le secteur des soins de suite et de réadaptation notamment les lits de convalescence, qui sont largement représentés dans le secteur privé. Leur volume s’est accru jusqu’aux années 2010 sous l’effet de la transformation opportuniste de lits dits « aigus ». On peut, aujourd’hui, se poser la question de leur pertinence alors que les programmes de réhabilitation et de récupération accélérée au domicile s’imposent partout. Une révision de ce parc est nécessaire, avec d’autant plus d’urgence que les besoins dans le médico-social s’accentuent.
Le secteur de la santé mentale, grand oubli de toutes les politiques hospitalières depuis 30 ans doit être réinvesti, afin de mettre un terme aux concentrations asilaires qui persistent malgré le discours, et redécouvrir la modernité de la prise en charge populationnelle et territoriale qu’offre la sectorisation.
Une gouvernance de territoire
Une coordination stratégique est à mettre en place. Elle interroge la capacité des Agences régionales de santé à en être les acteurs, à la fois pour un secteur public dont ils sont le bras tutélaire, et un secteur privé et libéral qu’ils connaissent mal et qu’ils n’ont jamais vraiment investi.
Est-ce la place de l’Assurance maladie ? Ou des collectivités territoriales ? Ou des deux, sous le regard d’un État Garant, représenté par son réseau d’agences.
Ce qui parait certain, quelle que soit la formule choisie : la place des usagers doit y être centrale !
Ce primat plaide plutôt en faveur d’une délégation de compétence à des collectivités territoriales, capables de faire vivre une réelle démocratie sanitaire.
Le secteur libéral à la manœuvre
Le secteur libéral est en cours de recomposition dans des communautés de professionnels qui peinent à prendre forme. Laissons encore un peu de temps aux professionnels et aux organisations qui les fédèrent pour montrer leur capacité à s’auto-organiser, au temps de l’épidémie qui peut agir comme accélérateur. Et encourager les groupements hospitaliers publics et privés à offrir des services et un adossement aux groupements de libéraux qui demandent surtout qu’on fluidifie les trajectoires patients dont ils sont les aiguilleurs.
Une politique de revenus des professionnels
D’une manière générale, la politique des revenus des professionnels de santé doit être revue et ne peut être laissée au seul jeu conventionnel entre l’Assurance maladie et les syndicats médicaux dans le secteur libéral, et aux déterminants de la fonction publique dans le secteur hospitalier public, et par voie de capillarité dans le secteur privé d’hospitalisation.
La hiérarchie des rémunérations entre professions soignantes et médicales et à l’intérieur même des professions est un empilement, mal assumé, acquis de l’histoire, de rentes de situations et d’injustices flagrantes qui pèsent sur la représentation collective des métiers du soin et leur utilité relative.
Si une revalorisation de 15 à 20 % sur 5 ans de l’ensemble des professions est acceptée, pour s’ajuster aux standards des pays comparables de l’Union, c’est certainement l’occasion de le faire !
La question des statuts
Revisiter les statuts qui entravent les dynamiques professionnelles et la fluidité des parcours est une réelle nécessité. Les médecins pourraient être dotés d’un statut d’exercice unifié public privé leur permettant des passerelles et un exercice mixte, dans l’ensemble du champ sanitaire et médico-social.
Les hospitaliers publics doivent comprendre et accepter qu’il n’y a pas de salut ni d’avenir dans une Fonction publique qui lamine les spécificités métiers et entrave les reconnaissances du mérite et de l’engagement.
C’est d’autant plus urgent que la reconnaissance de niveaux de qualification supérieurs, en pratique avancée chez les soignants fait exploser les cadres vermoulus de la gestion des emplois publics.
Le secteur privé hospitalier montre la voie en sachant promouvoir des trajectoires et une mobilité que la fonction publique peine à suivre. Si l’abandon du fonctionnariat paraît démesuré ou n’est pas accepté par le personnel et leurs représentants, il faut, à minima, assumer l’autonomie et la spécificité de la fonction publique hospitalière à l’égard de la fonction publique d’Etat à l’instar de ce que pratique actuellement la fonction publique locale, sous l’ombrelle des grands élus…
Dominique Maigne
Directeur d’hôpital honoraire
Ancien Délégué Général de la fédération des centres de lutte contre le cancer-Unicancer
Ancien Directeur Général de la Haute Autorité de Santé
Co-President de l’Universite du Change Management
*Cette tribune est également publiée sur le site de l’Université du change management en médecine (UC2m)