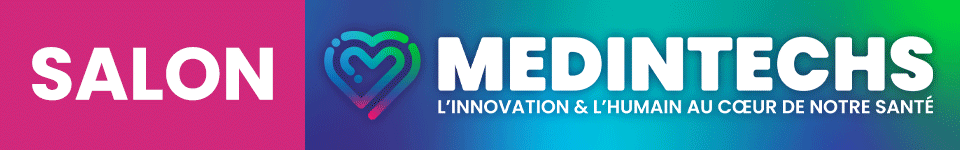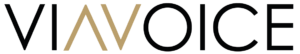Par Pascal Maurel – En présentant en grande pompe à l’Élysée son plan Ma santé 2022, le Président de la République répond-il aux attentes des Français et des professionnels qui sont fragilisés et inquiets du présent et de l’avenir ? En se saisissant directement des questions sanitaires et sociales, Emmanuel Macron tente d’équilibrer les premières mesures libérales de son quinquennat. Il trace des pistes originales qui devront être précisées, négociées et acceptées.
Recherche de consensus
La santé est donc enfin un des grands sujets politiques de cette rentrée. Le gouvernement s’y est résolu mais avec prudence. Il a pris son temps et a recherché des consensus. L’heure n’est pas, sur ce sujet, à la rupture. Le Président a affirmé avoir « un long compagnonnage avec le monde médical ». Il faisait sans doute référence à sa famille qui compte de nombreux professionnels de santé. Sa ministre, issue du sérail hospitalo-universitaire, s’est évertuée de son côté à partager des diagnostics avec les professionnels. Elle est même parfois allée au-delà des attentes d’un milieu mandarinal et expert qui n’avait pas nécessairement envie qu’on lui dise que « tout le système médical et universitaire était inadapté ». Elle a même montré du doigt celles et ceux qui avaient mené ou toléré pendant longtemps des formes de violences managériales. Mais en reconnaissant des dysfonctionnements, elle a montré sa capacité d’écoute des attentes des citoyens et des professionnels de terrain.
Premier examen réussi pour Agnès Buzyn
Pour leur part, les syndicats médicaux sont vite rentrés dans le rang en réintégrant la politique conventionnelle, à l’exception notable des infirmiers libéraux. Nicolas Revel, le directeur de l’Assurance maladie, déjà en poste sous Marisol Touraine, hier rejeté, est maintenant consacré. Du grand art ! Agnès Buzyn a lancé de nombreuses missions pour « panser les plaies ». Elle s’est beaucoup déplacée sur le terrain et a su gérer quelques écueils parmi lesquelles les négociations avec les opticiens et les chirurgiens-dentistes pour lancer le « zero reste à charge », une des promesses emblématique et assez électoraliste du candidat Macron. Avec ses équipes, elle a géré, sans prendre trop de coups, la canicule et des accidents dans les établissements de santé et dans les services d’urgence. Elle a donc réussi son concours d’entrée ! Reste à confirmer à l’heure des mises en œuvre.
Secteur de développement économique
Les comptes de la Sécurité sociale, bien qu’annoncés à l’équilibre en 2019, sont toujours en demi-teinte, surtout si la croissance est plus faible qu’attendu. Mais la santé ne semble plus être un secteur prioritaire pour les économies tant les malaises sont visibles. Et le Président annonça, en fin de discours élyséen un ONDAM à 2,5%, supérieur à celui des années précédentes. Et il se fit applaudir ! L’économiste et productiviste Macron considère la Santé comme un secteur de développement économique. Alors que la France dépense déjà 199,3 milliards d’euros (soit 2 977 euros par Français et par an), le gouvernement va porter à 2,5 % en 2019 la croissance des dépenses, soit une augmentation de 400 M€ !
Des médecins très incités
Depuis longtemps, le système médical libéral est empêtré dans ses contradictions. Les médecins conservent leur grande liberté et vont voir leurs contraintes administratives un peu soulagées par la création de 4000 assistants médicaux censés les recentrer sur les soins. En échange, des régulations et des nouvelles formes d’exercice leur seront imposées mais… sur la base d’incitations financières. L’accès aux aides et primes sera ouvert en contrepartie d’engagements sur des coopérations territoriales, pour mieux prendre en charge les besoins de santé.
Le fait que la Cnam* soit parvenue à faire rentrer dans le rang et à tordre le bras des chirurgiens-dentistes et des opticiens sur leurs tarifs et que les syndicats de médecins aient tous signé la convention médicale prouve que le gouvernement est capable de parvenir à ses fins. Les cliniques privées, par la voix de leur président Lamine Gharbi, se disent séduites. Hier vouées aux gémonies, elles sont maintenant réintégrées dans une politique compréhensive aux entreprises. Elles vont d’ailleurs bénéficier de prérogatives analogues à l’hôpital public dans les politiques territoriales. Le « en même temps » a peut-être trouvé, en Santé, une zone d’expérimentation fertile. Mais l’exercice médical isolé est banni, au moins dans les intentions. Et les médecins de ville assureront à nouveau des urgences de jour, sans barguigner. Ils devront en tout cas s’intégrer dans des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) aux contours très flous pour l’instant.
Les Français seront juges
Les Français vieillissants, soucieux de leur bien-être, attachés à une égalité républicaine et une ruralité mythifiée n’acceptent plus qu’un système aussi dépensier – le 3e du monde en termes de dépenses – ne leur permette pas de se soigner correctement dans toute la France. Les élus politiques de province, toujours influents, attaquent depuis un an le pouvoir actuel sur sa vision très urbanisée d’une politique moderne tournée plus volontiers sur le digital et la réussite personnelle. L’abandon des services publics, qui ne date pas d’hier, fait sans aucun doute le lit des extrémismes. Dans notre « village planétaire », tout se sait et se compare.
D’autant que le gouvernement, au-delà du Dossier médical partagé (DMP), veut introduire plus de digital en proposant un espace numérique patient personnalisé. À l’heure des réseaux sociaux, les médecins ne peuvent plus négliger les attentes des malades au profit de leurs intérêts et avantages. Leur reconnaissance par la population s’accompagne mal d’un certain esprit boutiquier incarné par le paiement direct, lui-même à la clé d’une multiplication des actes et de la non-prise en charge de la complexité des maladies chroniques.
Les professionnels vivent ces changements nécessaires avec méfiance. Ils perçoivent les enjeux sanitaires qu’ils subissent concrètement avec leurs populations âgées et handicapées, leurs malades chroniques et la paupérisation générale. Mais ils redoutent les remèdes qu’il faudrait que l’on administre au système tout entier. Les syndicats de ce point de vue sont sans doute en avance sur leurs troupes. En négociant des forfaits sur objectifs, des aides et des soutiens qui sonnent le glas d’un exercice médical individualiste, fondé exclusivement sur le paiement à l’acte et une indépendance totale, ils ont compris qu’ils étaient dos au mur. C’est la raison pour laquelle, le gouvernement juge que le momentum lui est favorable.
Un hôpital empêché
L’hôpital est en grande difficulté. Tout dépend évidemment des établissements et des services. Plusieurs hôpitaux et cliniques des grandes métropoles excellent. Mais les difficultés sont nombreuses. De nombreux postes hospitaliers restent vacants dans des disciplines de pointe comme la radiologie* (vidéo Société française de radiologie). Les suicides de médecins et d’infirmiers révoltent la communauté professionnelle. Les difficultés managériales sont dénoncées par les soignants mais aussi, ce qui est un comble, par les cadres administratifs et de gestion. Les directions d’établissements ont été coupées de la réalité soignante. Il y a quinze ans le Pr Jean François Mattei avait tenté d’associer les médecins aux décisions hospitalières. Une co-gouvernance s’était établie qui redonnait confiance aux équipes. Ce travail fécond a été balayé par ses successeurs de droite et de gauche centrés, pour les uns, sur les résultats économiques et, pour les autres, sur les rapports de pouvoirs. Cette crise est délétère pour l’ensemble du système et ce gouvernement en a enfin pris conscience. Il remet en selle les commissions médicales d’établissements et même les services hospitaliers. Ce qui, sur ce dernier point, n’est pas très moderne mais qui est finalement demandé par le corps médical.
Plus profondément, une crise de management s’est installée dans l’hôpital public. Les structures sont lourdes, très hiérarchisées dans un monde qui nécessite plus d’agilité. Les Jeunes professionnels ne se sentent pas bien dans des organisations qui leur laissent peu d’autonomie. Le rapport Rousseau** (en pièce jointe ) demandé par la ministre écrit : « Même si la satisfaction de soigner et de sauver est toujours présente au quotidien chez les soignants, un mal-être s’est désormais installé profondément. Ce malaise provient largement d’une évolution des conditions d’exercice des métiers au quotidien, de la relation au malade souvent présentée comme « empêchée », d’un recul du travail en équipe, du sentiment de n’avoir pas le temps de faire l’essentiel, ou dans un autre registre, du manque de perspectives d’évolution lorsque l’on est soignant à l’hôpital public. L’exercice professionnel à l’hôpital a perdu de son sens. » L’avertissement est terrible.
Recul du travail en équipe
Au sein de l’Université du Change Management***(www.universitéduchangemanagement), David Autissier, professeur à l’Essec, directeur des chaires Innovation et Changement met en évidence que « ce besoin d’autonomie correspondrait à une évolution sociétale qui se traduit par la perte d’attractivité des grands groupes et des grosses organisations auprès des jeunes diplômés qui préfèrent aujourd’hui s’investir dans l’environnement des start-ups ». David Autissier souligne encore « que la réponse à la question jusqu’où laisse-t-on de l’autonomie aux personnes dans un cadre collectif est devenue un des enjeux essentiels des nouvelles organisations ». Les mesures lancées, dont l’affaiblissement des statuts et la création d’un statut unique de praticien hospitalier corrigeront un peu les scories d’un système corseté, empêtré dans ses habitudes, ses hiérarchies, dur avec ses cadres et ses jeunes, peu ouvert aux autres formes d’exercice et aux enjeux technologiques et scientifiques actuels. Mais au-delà des bonnes intentions gouvernementales, les solutions devront être trouvées sur le terrain, au plus près des réalités vécues.
Une réforme étatique
Le gouvernement d’Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Agnès Buzyn cherche à avancer sans la voie législative. Les difficultés des grandes lois Juppé de 1995, HPST de Roselyne Bachelot et de Nicolas Sarkozy ont sonné le glas des grandes « cathédrales législatives ». Marisol Touraine elle-même a tout fait pour retarder sa propre loi qui était pourtant sans grande ambition. Pour autant, des changements techniques pourront-ils régler des dysfonctionnements majeurs et rétablir la confiance avec les professionnels et les citoyens ?
Si certaines mesures annoncées appelleront un « véhicule législatif » en 2019, le gouvernement renonce à tourte mesure d’ampleur institutionnelle. Pas de déconcentration, ni de décentralisation, ni de régionalisation comme dans les pays nordiques pourtant admirés par le Président de la République. Valérie Pécresse et quelques grands ténors régionaux n’obtiendront que peu de moyens de l’État tutélaire qui reste résolument centralisateur, à la manœuvre et qui ne délègue pas. L’aristocratie administrative française est rétive à toute perte de pouvoir et d’influence et le Président, qui en est issu, ne cède rien de son pouvoir d’agir. Nos grands fauves politiques craignent de lâcher leurs proies et leurs territoires au profit de roitelets régionaux très vite opposants au suzerain.
Et pourtant, comment ne pas penser que les grandes régions mises en place depuis la Loi de 2017 ne seraient pas en mesure d’investir et de s’investir dans la Santé ? Pourquoi ne pourraient-elles pas lever des fonds pour prendre vraiment en charge des politiques sanitaires et de prévention ? Une instance régionale décentralisée et regroupée dans des agences régionales de santé revigorées saurait agir de manière plus précise que ne peut le faire l’Etat pour régler les besoins territoriaux et locaux. Visiblement, il n’en sera rien.
Jouer collectif
Le collectif est le maître mot. Les médecins de ville devront assurer, ensemble, les urgences de jour, ce qu’ils ne font plus. De leur côté, les hôpitaux et les cliniques, en lien avec les professionnels libéraux, devront assurer, en concertation, des services de proximité dans les zones défavorisées. Avec les hôpitaux de proximité, le gouvernement remet en selle des hôpitaux locaux, condamnés sur des critiques d’efficience. La transformation digitale, la mise sur orbite de l’intelligence artificielle, la génomique qui met sur le marché des médicaments si chers que même les États riches pourraient ne plus pouvoir se les payer, doit contribuer à modifier les pratiques.
De l’espace pour les vents contraires et les lobbys
Emmanuel Macron n’a lancé que des axes stratégiques et quelques mesures cosmétiques comme l’envoi de 400 médecins salariés pour les déserts médicaux. La réforme des études médicales est quant à elle emblématique. La fin du numerus clausus et la réforme de l’internat tord le cou à de vieillies pratiques rigoristes et rigides du système universitaire français, au détriment des enfants des classes moyennes et populaires françaises.
Mais tout ne fait que commencer. Les diverses corporations, après avoir exprimé un unanimisme de façade, vont tenter de défendre leurs avantages acquis. Le gouvernement a, en effet, laissé beaucoup d’espaces aux vents contraires et aux lobbys. La psychiatrie est « élevée au rang de priorité » mais… en quelques lignes seulement. La spécificité infirmière (660 611 infirmiers) a du mal à émerger en profession autonome car la vision du pouvoir reste très médicale. En revanche, c’est sans doute la première fois que des responsables ministériels évoquent la situation des aides-soignants. Les déficiences des maisons de retraite ont rappelé le rôle essentiel de ces 390 000 professionnels. Le traitement sera long jusqu’à la guérison. Pourvu que le malade tienne le coup sans trop de fièvre et collapsus.