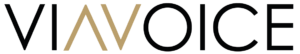Président de l’Uniopss, grande union transversale du secteur privé non lucratif sanitaire, social et médico-social, Daniel Goldberg co-porte avec la Mutualité Française et cinq autres acteurs du monde sanitaire et médico-social (la CFDT, l’UNPS, l’Association des assureurs mutualistes, la FEHAP, l’UNSA), les États généraux de la santé et de la protection sociale lancés le 17 novembre dernier. Ancien député de Seine-Saint-Denis, engagé de longue date sur les sujets de logement et de solidarité, il défend avec ces États généraux une démarche singulière : partir de la parole des citoyens et des territoires pour remettre la santé et la protection sociale au cœur du débat public, à l’approche des échéances électorales de 2026 (municipales et sénatoriales) et 2027 (présidentielle). Il en détaille les enjeux pour La Veille Acteurs de Santé.
Propos recueillis par Renaud Degas
Pourquoi l’Uniopss a-t-elle choisi de s’associer à ces États généraux proposés par la Mutualité Française ?
Daniel Goldberg : L’ADN de l’Uniopss, c’est la transversalité. Nous rassemblons des grandes fédérations sanitaires et médico-sociales, des associations de soins, d’addictologie, d’habitat accompagné, des centres de santé, des acteurs du handicap, du grand âge, du domicile… Bref, tout un pan du secteur non lucratif qui met en œuvre les politiques publiques sur le terrain.
Dans un contexte de fractures sociales et territoriales, de débat public atrophié et de défiance généralisée, nous considérons que nous avons une responsabilité particulière. Non pas pour ajouter un plaidoyer de plus à ceux que nous produisons déjà sur les lois de finances ou de financement de la Sécurité sociale, mais pour créer un espace où les Françaises et les Français peuvent reprendre la parole sur la santé et la protection sociale. Notre légitimité, c’est à la fois l’expérience de terrain et la capacité à organiser ce débat de manière structurée.
Vous parlez d’une « non-effectivité des droits ». Quel est, pour vous, le symptôme le plus criant de la crise actuelle ?
D.G. : Sur le papier, notre modèle est remarquablement protecteur : chacun a droit à une consultation, à un accompagnement en cas de handicap ou de perte d’autonomie, à des services à domicile… Mais, dans les faits, ce droit n’est pas toujours effectif.
Très concrètement, dans les réseaux que je préside, des directrices et directeurs d’établissements ou de services me disent : « On a une notification d’heures d’aide à domicile, mais on ne peut pas intervenir : nous n’avons ni les moyens financiers, ni les professionnels ». Même chose pour l’accueil en structure handicap, pour l’accès à un EHPAD dans certains territoires.
Ce décalage entre le droit théorique et la réalité vécue est profondément destructeur pour la société. Il nourrit la colère et la perte de confiance dans les institutions, et il s’ajoute à une crise plus large du fonctionnement des services publics. Nous devons l’entendre et l’écouter. Et recueillir toutes les suggestions et propositions pour y remédier.
« Le décalage entre le droit théorique et la réalité vécue est profondément destructeur pour la société. Il nourrit la colère et la perte de confiance dans les institutions. »
Concrètement, comment vont se dérouler ces États généraux et comment garantissez-vous la transparence de la démarche ?
D.G. : Nous avons voulu une méthode en plusieurs temps. D’abord, une grande consultation par questionnaire, ouverte largement. Ensuite, des ateliers territoriaux, au plus près des réalités de terrain, dans lesquels citoyens, professionnels, responsables associatifs et élus pourront confronter leurs expériences et leurs propositions.
À l’automne 2026, une forme de « convention citoyenne » viendra travailler ce matériau : l’idée est de dégager un socle de constats et de propositions, et non de produire un rapport de plus qui resterait sur une étagère.
Nous avons pris un engagement très clair : tout ce qui sera produit sera rendu public. C’est une question de cohérence. L’Uniopss a souvent critiqué l’absence de publication de certains rapports ou cahiers de contributions dans des démarches nationales. Nous ne pouvons pas demander de la transparence à l’État et ne pas nous l’appliquer à nous-mêmes. Un comité de garants indépendants veillera d’ailleurs à la qualité et à la sincérité de la démarche.
Le périmètre est vaste – santé et protection sociale. Comment éviter un débat éparpillé ?
D.G. : Nous avons volontairement posé des limites. Il ne s’agit pas de traiter « toute » la protection sociale. Nous nous concentrons sur la santé au sens de l’OMS – donc incluant l’autonomie, le médico-social – et sur la cinquième branche, celle du grand âge et du handicap.
Nous n’aborderons pas, par exemple, les retraites ou la branche famille en tant que telles. Non pas parce que ces sujets ne sont pas importants, mais parce que personne ne peut raisonnablement traiter tous les enjeux de la protection sociale dans un seul exercice.
Notre démarche reste toutefois ambitieuse : santé, autonomie, organisation des soins, accompagnement à domicile, établissements, coordination des acteurs, reste à charge… Mais l’angle commun, c’est le « soin » et la manière dont notre société prend soin des plus vulnérables. Ce fil rouge doit nous permettre de structurer le débat et d’éviter de « partir dans tous les sens ».
« Nous avons pris un engagement très clair : tout ce qui sera produit sera rendu public. C’est une question de cohérence. »
Qu’attendez-vous de cette démarche pour le secteur non lucratif et pour vos adhérents ?
D.G. : D’abord une opportunité de prendre du recul. Beaucoup de nos associations existent depuis des décennies, parfois plus d’un siècle. Elles ont dû se transformer, développer l’approche domiciliaire, adapter leurs établissements à l’évolution des besoins… mais elles manquent cruellement de temps pour penser leur action.
Ensuite, une meilleure reconnaissance du rôle du secteur privé non lucratif. La plupart des personnes accompagnées ne savent même pas qu’elles ne sont pas prise en charge dans un service public stricto sensu, mais dans une structure associative ou fondationnelle, financée pour mettre en œuvre les politiques publiques.
En organisant des débats dans les conseils de la vie sociale, avec les aidants, les personnes accueillies, les professionnels, nous espérons à la fois enrichir notre réflexion interne et rendre plus visible ce que le secteur non lucratif apporte au quotidien, dans la proximité.
Vous insistez beaucoup sur les enjeux territoriaux et le domicile. Qu’aimeriez-vous faire remonter des États généraux sur ces sujets ?
D.G. : Il manque aujourd’hui des lieux où l’on discute vraiment de l’offre à l’échelle d’un territoire. Les services à domicile sont un bon exemple : l’État pilote les SSIAD, les départements les services d’aide. Sur le terrain, tout le monde s’accorde sur la nécessité d’un continuum autour de la personne, mais les cadres de pilotage restent éclatés.
Nous avons besoin d’une « vraie » cinquième branche, dotée d’un pilotage clair et d’espaces de concertation où départements, ARS, communes, associations, professionnels libéraux et usagers peuvent construire ensemble des réponses adaptées aux réalités urbaines, rurales ou périurbaines.
Dans beaucoup de territoires, les services à domicile et les professionnels libéraux sont les seuls à permettre aux personnes de rester à domicile. Si les États généraux peuvent mettre en lumière ces réalités et nourrir une réflexion collective sur l’offre d’autonomie, ce sera déjà un résultat précieux.
Le financement est au cœur des tensions : mutualisation, reste à charge, franchises… Comment associer les citoyens à un débat aussi technique ?
D.G. : Nous n’allons pas transformer les Français en experts du financement de la Sécurité sociale. En revanche, chacun peut se prononcer sur les grands choix de société. Voulons-nous continuer à mutualiser les risques de l’existence – maladie, perte d’autonomie – ou glisser vers un modèle plus assurantiel, où chacun se couvre individuellement ?
Aujourd’hui, on voit bien une tentation de faire peser davantage de coûts sur les ménages : franchises, transferts vers les complémentaires, reste à charge en EHPAD ou à domicile. Dans nos établissements non lucratifs, on est déjà entre 1 800 et 2 300 euros de reste à charge mensuel, davantage encore dans le lucratif. Pour beaucoup de familles, c’est insoutenable.
Avec le vieillissement, le renchérissement des coûts d’accompagnement, les risques de nouvelles pandémies ou les effets sanitaires du changement climatique, nous avons besoin d’un débat adulte sur la manière dont nous finançons collectivement la protection sociale. Les États généraux doivent contribuer à le rendre possible, de façon apaisée et informée.
« Nous avons besoin d’un débat adulte sur la manière dont nous finançons collectivement la protection sociale. »
En creux, vous posez aussi une question démocratique…
Daniel Goldberg : Oui, parce que nous ne sommes pas là pour faire campagne. Ni Eric Chenut – Président de la Mutualité française-, ni moi, ni les autres co-porteurs des États-généraux n’avons vocation à être candidats à l’élection présidentielle. Notre enjeu n’est pas de défendre une ligne partisane, mais de créer des espaces de délibération où l’on puisse construire des compromis entre citoyens, professionnels, élus et acteurs associatifs.
Historiquement, les États généraux, en 1789, reposaient sur des cahiers de doléances portés par des délégués. Nous ne reproduisons évidemment pas ce schéma, mais l’idée reste la même : organiser la remontée de la parole des territoires, accepter la complexité, sortir des slogans.
Si, à notre place, nous contribuons à ce que la santé et la protection sociale redeviennent des sujets centraux du débat public, portés par celles et ceux qui vivent les difficultés au quotidien, alors nous aurons déjà fait œuvre utile. Le reste dépendra aussi de la manière dont les responsables politiques s’empareront de ce matériau.