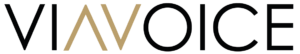À l’occasion du mois de mobilisation d’Octobre Rose contre le cancer du sein, La Veille Acteurs de santé a rencontré Catherine Cerisey, entrepreneuse, bénévole dans de nombreuses associations et enseignante de la perspective patient à l’Université. Celle qui a vaincu un cancer du sein et une rechute au début des années 2000 partage son expérience et son expertise d’un système de santé qu’elle cherche à améliorer depuis 15 ans, avec toute la combativité et la résilience d’une femme hors du commun.
Propos recueillis par Camille Grelle
D’où vient votre engagement ?
Catherine Cerisey : J’ai été diagnostiquée d’un cancer du sein en décembre 2000 suivi d’une rechute deux ans plus tard. Déclarée en rémission totale en 2009, j’ai ouvert un blog, « Après mon cancer du sein », pour partager des informations sur le cancer du sein ce qui, à l’époque, n’existait pas. Je l’ai tenu jusqu’en 2017 avant d’arrêter car sa portée – 3 millions de vues, 1,5 million de visiteurs uniques – devenait incompatible avec mes autres activités… Mais cela m’a amenée à m’investir dans le milieu associatif.
J’ai en effet été approchée par une membre de la HAS qui, interpellée par mon contenu et ma communauté, m’a invitée à les rejoindre comme experte. Par la suite, j’ai notamment été vice-présidente de Cancer Contribution et administratrice d’Europa Donna France et d’Étincelle Île-de-France*.
Au-delà de votre implication associative, vous avez mis la démocratie en santé au cœur de votre vie professionnelle. Comment cela s’est-il passé ?
C.C : En effet, après un licenciement et un divorce, j’ai cofondé en 2012 Patients & Web, une agence de conseil en santé pour aider les acteurs et les partenaires du système de santé à coconstruire avec les patients atteints de maladies chroniques des outils (sites internet, applications, films, podcasts, webradios, livrets, etc.) adaptés à leurs besoins et à leurs usages. Puis, en 2016, j’ai été contactée dans le cadre de l’ouverture d’un programme d’enseignement initial dédié aux médecins généralistes et dispensé par les patients. Je suis donc devenue enseignante de la perspective patient à la faculté de médecine Sorbonne Paris Nord auprès des internes en médecine générale.
Enfin, en 2021, j’ai cocréé Entends Moi, une start-up de e-santé. Elle propose un algorithme d’intelligence artificielle utilisant le traitement automatique du langage pour analyser les retours d’expériences des patients hospitalisés pour permettre aux acteurs hospitaliers (directeur qualité, chefs de service, médecins, infirmiers, etc.) de piloter l’expérience patient au fil de l’eau et, in fine, d’améliorer leurs parcours.
Entre votre expérience et vos multiples casquettes, quels constats avez-vous été amenée à dresser quant au parcours des patients atteints de maladie chronique en général et de cancer en particulier ?
C.C : Ce genre d’événement bouleverse tout sur son passage et entraîne des dommages collatéraux familiaux, amicaux, professionnels. Dans le monde du travail, cela a un peu évolué ces dernières années grâce à des acteurs comme cancer@work qui travaillent beaucoup sur le sujet pour sensibiliser les entreprises et accompagner les collaborateurs. Mais la réalité, c’est qu’il y a encore des femmes et des hommes qui subissent la double peine maladie-perte d’emploi. Et puis, il faut également avoir conscience que certains patients n’ont pas nécessairement envie de revenir à leur ancienne vie après les traitements. Certains veulent se reconvertir, changer de voie, aider.
Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réaction : c’est légitime dans un sens comme dans l’autre et tout s’entend mais il faut pouvoir avoir le choix. La résilience, pour moi, c’est parvenir à faire quelque chose de cet épisode, que cela soit dans le domaine de la santé comme je l’ai fait ou dans tout autre domaine. En un sens, mon blog m’a permis d’apaiser la colère et le sentiment d’injustice que j’ai pu ressentir : je me dis que j’ai tenté de faire changer le système de santé, d’aider à mon niveau. C’est ma définition de la résilience mais elle n’engage que moi : toutes les réactions sont légitimes et acceptables.
En 25 ans d’implication, comment avez-vous vu évoluer le système de santé ?
C.C : Ce qui a le plus changé à mon sens, c’est sans aucun doute la prise en soins – un terme que je préfère de loin à celui de prise en charge : les patients ne sont pas des charges ! En 2002, la Loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré entre autres l’obligation d’information et de consentement des patients ce qui a permis de les rendre beaucoup plus acteurs grâce au processus de décision partagée avec ses phases d’information, de négociations et de choix de traitement.
Mais cela reste malgré tout dépendant du professionnel de santé que l’on a en face de soi. Et contrairement à ce qu’on pense, ce ne sont pas toujours les plus jeunes qui sont le plus à l’écoute…
Quel regard portez-vous sur le rôle des réseaux sociaux dans cette évolution du système de santé ?
C.C. : Les réseaux sociaux ont évidemment changé la donne : les patients se parlent, échangent des informations et ceux qui ne connaissaient pas les associations de patients ont désormais accès à des patients « experts ». Les associations communiquent et peuvent toucher une plus large audience via ces canaux. Les informations à disposition sont plus fiables et les fausses restent accessibles peu de temps avant d’être démenties.
Et tout cela est très bénéfique : les patients sont moins en proie à des mauvais conseilleurs. Finalement, il y a une certaine autorégulation par l’intelligence collective.
Que reste-t-il à faire pour améliorer la démocratie en santé selon vous ?
C.C. : La plus grande révolution en marche, c’est la prise en compte de la parole des patients, de manière individuelle et collective, et je suis convaincue que l’enseignement par les patients aux professionnels de santé va faire encore davantage avancer les choses. Mais si la démocratie en santé est effective, elle n’est pas encore automatique ni pleinement acceptée. Il suffit de regarder ce qui s’est passé dans les médias durant le Covid : pas un seul représentant de patients n’a été convié aux débats qui ont pourtant été légion ! C’est la preuve que les choses changent mais qu’il y a encore du travail.
Et sur le versant de la prise en soins ?
C.C. : Il faut travailler sur une prise en soins encore plus globale et incluant, outre les acteurs des traitements, ceux des soins de support, les associations, les acteurs institutionnels comme l’INCa, la HAS, etc. Il nous faut également travailler sur les déserts numériques car ce sont aussi les déserts médicaux. Or, les personnes qui n’ont pas accès à l’information sont pourtant celles qui en ont le plus besoin. On reproche aux patients de se rendre aux urgences mais c’est parce qu’ils n’ont pas d’autres choix !
À mon sens, on commet une erreur fondamentale en ne misant pas sur la médecine de premier recours. Il faut sortir de la vision hospitalo-centrée dominante au profit d’une politique de proximité qui s’appuie notamment sur des médecins de garde. Les maisons de santé, les CPTS sont des débuts de solution mais il faut aller encore plus loin.
*Cancer Contribution est une plateforme collaborative engagée dans la démocratie en santé : https://www.cancercontribution.fr/
Europa Donna France est la branche française d’une coalition européenne d’information et de soutien des femmes atteintes d’un cancer du sein : https://www.europadonna.fr/
Étincelle est une association qui propose des soins de support aux malades : https://www.etincelle.asso.fr/