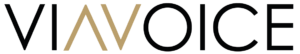Synthèse par Alexandre Terrini – Le débat organisé le 29 mai dans le cadre des Contrepoints de la Santé a constitué un parfait lever de rideau d’une séquence bioéthique marquée par la publication du rapport des Etats généraux de la bioéthique le 5 juin. Il a vu se confronter le Professeur Jean-François Delfraissy, Président du Comité consultatif national d’éthique (CCNE), et Emmanuel Loeb, psychiatre et Président de l’Intersyndicale nationale des chefs de cliniques (ISNCCA).
Intégrale et temps forts (vidéos)
Sondage Les Contrepoints-BVA
Baromètre Les Contrepoints-BVA
Au fait, la bioéthique, c’est quoi ? « Trouver un équilibre très difficile entre, d’un côté, les avancées scientifiques majeures et, de l’autre, une société qui évolue. En somme, savoir comment l’on relie ces avancées scientifiques et ces avancées sociétales », répond Jean-François Delfraissy. La tâche vire souvent à la quadrature du cercle, d’autant que notre beau pays présente la particularité d’avoir instauré une révision de la loi sur la bioéthique tous les sept à huit ans. Le tout en se conformant à un modèle unique en son genre qui vise à réunir, de manière constructive et complémentaire, politiques, citoyens et sachants.
La préservation de la démocratie sanitaire
Pour cela, le CCNE a innové en organisant, pour la première fois de son histoire, des États généraux de la bioéthique, lesquels ont été clos il y a peu. Le but de la manœuvre étant « d’essayer de palper, de sentir et de faire remonter ce que pensent nos concitoyens et les professionnels de santé », résume Jean-François Delfraissy. Et ce, sur des thématiques incontournables que sont, entre autres, la Procréation médicalement assistée (PMA), la fin de vie, la génomique, la place du citoyen dans les nouveaux systèmes de soins ou encore, la santé et l’environnement. Avec, en toile de fond, la préservation, voire la consolidation de la démocratie sanitaire. Sachant que d’après une enquête BVA, les principales préoccupations des Français en la matière sont, par ordre décroissant d’importance, la prise en charge de la fin de vie (74 % de citations), la capacité à gérer sa fin de vie même en dehors de toute pathologie lourde (69 %), la santé et l’environnement (65 %) et enfin, le don et la transplantation d’organes (42 %).
« Le cœur de notre action est autour du patient »
« Le cœur de notre action est autour du patient. Il n’est pas de faire plaisir aux politiques ni aux professionnels de santé », insiste le patron du CCNE. Le tout avec l’ambition de ratisser large. C’est pourquoi quatre outils ont été mis en place dans le cadre desdits États généraux. Tout d’abord, 250 débats ont été organisés en régions, auxquels ont assisté 18 500 personnes. En outre, un site Internet a été mis en ligne pour accueillir quelques 65 000 contributions. De son côté, le CCNE a effectué la bagatelle de 150 auditions d’associations, de sociétés savantes, de représentants des autorités religieuses etc. Enfin, un comité citoyen comprenant onze hommes et autant de femmes issus de tous horizons géographiques et sociaux a été constitué. Ses membres ont eu toute latitude pour donner leur avis sur divers sujets. Ils ont également été invités à plancher plus particulièrement sur deux thèmes épineux : la fin de vie et le suicide assisté, d’une part ; l’utilisation éventuelle de la génomique en population générale, d’autre part.
Faible implication des médecins
Résultat des courses ? Quelles tendances se dégagent ? Il faudra patienter jusqu’à la rentrée pour le savoir, quand le CCNE remettra au Gouvernement la synthèse de ses États généraux. Et Jean-François Delfraissy s’est bien gardé de vendre la mèche. Sur la forme, on apprend néanmoins que le fait d’avoir procédé de la sorte « a permis de réveiller une réflexion et une appétence de la population pour la bioéthique », se félicite le Professeur Delfressy. Quid, en revanche, de la prise de conscience de ces enjeux par les professionnels de santé ? « Peut mieux faire », rétorque le Président du CCNE. On notera notamment la faible implication des médecins, tant au niveau individuel qu’à échelon collectif. En clair, l’Ordre a préféré réserver la primeur de sa réflexion sur le sujet aux parlementaires et au Gouvernement, lorsqu’interviendra la phase politique et législative d’amendement de la loi sur la bioéthique. En effet, ces États généraux ne sont que le premier étage de la fusée destiné à alimenter en bonnes idées les parlementaires et les tutelles qui trancheront dans un second temps.
La fin de vie pas gérée de manière optimale
Sur le fond donc, on ne sait pas encore grand-chose. Pour ce qui est de la fin de vie, précise le Professeur Delfraissy, « l’ensemble des Français qui se sont manifestés considèrent que celle-ci n’est pas gérée de manière optimale dans le modèle français, certains voulant aller plus loin, d’autres non ; que le problème de la fin de vie sont avant tout celui des personnes du quatrième âge, ce qui pose la question des conditions de leur prise en charge dans les Établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ; que la loi Claeys-Leonetti n’est ni connue ni appliquée au niveau des équipes de soignants. Quant aux professionnels de santé, ils demandent qu’on les laisse utiliser cette loi. » Pour ce qui est des transplantations, les Français sont attachés aux dons d’organes anonymes et gratuits. En revanche, les avis sont divisés concernant la PMA, une courte majorité se dégageant en faveur de sa mise en œuvre en faveur des femmes seules et des couples de femmes. Quant à la Gestation pour autrui (GPA), elle fait la quasi-unanimité contre elle dans la mesure où les personnes consultées considèrent que « telle qu’elle est proposée actuellement, elle ne correspond pas à un certain nombre de réflexions éthiques », précise Jean-François Delfraissy, en particulier en raison de la marchandisation du corps qu’elle induit.
La question de la clause de conscience
Dans tous les cas, il ne faut pas oublier le professionnel de santé qui se retrouve face au patient mais aussi à sa propre conscience. Tel est le message d’Emmanuel Loeb : « Que ce soit pour la fin de vie ou la procréation, on est dans une notion de technicisation du processus du vivant. On demande au médecin de donner un avis sur la capacité de l’individu soit de créer la vie, soit d’y mettre fin avec toutes les représentations de ces moments particuliers que chaque médecin a dans sa pratique quotidienne. C’est au médecin de se conformer aux choix de société. C’est pourquoi la question de la clause de conscience se pose pour ceux qui ne partageraient pas ces choix. Ont-ils le droit de s’y soustraire ? » That is the question.
Organisé et animé par Philippe Leduc (LDC santé), Pascal Maurel (Ortus) et Renaud Degas (La Veille des acteurs de la Santé – Presse Infos +) au Restaurant Opéra.
En partenariat avec Le Groupe Pasteur Mutualité, Groupe Point Vision, MSD, Carte blanche, Inter Mutuelles Assistance, et BVA.