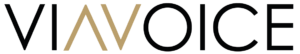La deuxième édition de l’Université des déserts médicaux et numériques se déroule les 20 et 21 septembre prochains à Lucenay-lès-Aix.
Trois questions à Guillaume de Durat, initiateur de l’université et président de l’association éponyme sur le contexte de cet événement et les questions qui y seront abordées.
Pourquoi avoir fait le choix de mettre en place une deuxième édition des déserts médicaux et numériques ?
Guillaume de Durat : La question d’une deuxième édition des déserts médicaux et numériques s’est posée quelques mois après les retombées médiatiques de la première édition… Après l’autosaisine du CESE, les articles et interviews, un certain nombre d’acteurs qui n’étaient pas présents ont regretté de ne pas avoir participé, pensant que c’était un évènement qui allait être récurrent.
D’autre part, le sujet des déserts médicaux a été très souvent abordé par les médias, par les citoyens, par les acteurs et le monde politique. Il est devenu une préoccupation majeure des autorités et des Français au cours de ces deux dernières années, passant d’un sujet local à un sujet national.
Quelle sera la thématique clé de cette deuxième édition ?
G.d.D : La thématique clé est le couple santé-numérique avec la même approche que lors de la première édition mais deux années plus tard : quid de la santé dans un contexte de virage numérique, où la télémédecine (ou télésoin) doit permettre de pallier les délais d’accès à un professionnel de santé, généraliste comme spécialiste dans un pays dont la fracture numérique devient un sujet majeur. Les récentes mises en demeure de l’ARCEP, le gendarme des télécoms, quant au défaut de couverture numérique de certains territoires, en est la preuve.
Cette fracture, source d’inégalités dans de nombreux domaines, est particulièrement criante en santé. Au-delà du télésoin qui ne se développe pas comme il le devrait, les domaines de la prévention et l’appropriation par les Français des outils numériques devenus indispensables à une saine gestion des ressources de notre système de santé (DMP, DP, informations grand public…), ne peuvent se faire sans un accès à un réseau fiable. Les solutions numériques mises en place se trouvent alors limitées dans leur efficacité.
De quel(s) pays pourrions-nous nous inspirer pour régler la question des déserts médicaux ? Pourquoi ?
G.d.D : La question des déserts médicaux ne peut être transposable à d’autres pays qui gèrent de manière diverse la santé. Soit il s’agit d’Etats Fédéraux, de Länder, ou de provinces autonomes, soit il s’agit de pays dans lesquels tout était à construire. En France, nous ne partons pas de loin, bien au contraire, un fort maillage territorial est encore représenté par les pharmacies qui subsistent dans les villes et les villages. Aborder les déserts médicaux par la modification du numérus clausus, les incitations à l’installation… ne peut résoudre durablement cette question comme nous pouvons d’ores et déjà le constater.
Lors de la première édition, les constats ne portaient pas sur une absence de financement mais sur l’absence de volonté humaine, un manque d’organisation et aussi un manque de coordination entre les politiques des différentes ARS de nature à générer des inégalités d’accès aux soins. Certains territoires métropolitains souffrent des déserts médicaux là où d’autres ont trouvé des solutions (ultra marins par exemple).
Ainsi, c’est bien la conceptualisation des initiatives qui fonctionnent et qui doit donc être dupliqué sans forcément regarder ce qui se fait à l’étranger. Les règles d’installation ne sont pas les mêmes, il faut œuvrer avec la politique conventionnelle, les Ordres et les syndicats. La solidarité devient indispensable pour ne pas perdre les acquis que la France a connu et il faut que chacun y mette du sien dans un secteur qui repose depuis 1946 sur cette valeur.