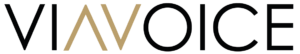Dans cette seconde partie de l’interview accordée à La Veille Acteurs de santé, Thomas Courbe, le directeur général des entreprises, revient sur un rôle de plus en plus visible de la DGE : travailler et accompagner les acteurs de santé concrètement sur des sujets stratégiques comme les problématiques de financement ou d’intégration de l’intelligence artificielle.
Comme on a pu l’entendre lors du congrès de janvier dernier de l’Union nationale des professions libérales (UNAPL), vous avez été missionné pour réfléchir à de nouvelles modalités de financement des professions libérales. La problématique concerne de plus en plus les professionnels de santé libéraux. Comment abordez-vous ce sujet ? Quels sont les objectifs ?
Thomas Courbe. La DGE suit avec attention le sujet. Face aux alertes de professionnels, l’ordonnance du 8 février 2023 sur l’exercice en société des professions libérales réglementées a étendu la remontée d’informations aux ordres des sociétés aux modalités de gouvernance, au-delà de la composition du capital. Un rapport a été publié par le Sénat en 2024 et une mission inter-inspections IGF-IGAS, proposée par la DGE et la Direction générale de l’offre de soins, remettra bientôt ses propositions.
La DGE consulte actuellement les parties prenantes, en prenant comme périmètre l’ensemble des professions réglementées, et pas seulement celles de santé, car le phénomène touche d’autres secteurs. Partant du constat, partagé par le Sénat, que la financiarisation doit être replacée dans un contexte plus vaste d’accès aux financements, de développement économique et de culture financière, le sujet a été structuré autour de trois axes, autour desquels nous articulons la concertation, annoncée lors du dernier congrès de l’UNAPL :
- Identifier les leviers pertinents de régulation, avec mesure et pragmatisme ;
- Favoriser la diversification des stratégies de financement des professionnels à tous les stades de la vie de l’entreprise ;
- Identifier le besoin de développer la culture financière des professionnels, généralement peu formés et sensibilisés à la gestion d’entreprise.
Notre objectif sera de trouver le meilleur équilibre possible entre protection de l’indépendance, accès aux financements, qualité des soins et des prestations, et préservation de la liberté d’entreprendre.
Notre objectif sera de trouver le meilleur équilibre possible entre protection de l’indépendance, accès aux financements, qualité des soins et des prestations, et préservation de la liberté d’entreprendre.
Lors du Sommet pour l’Action sur l’IA, qui s’est tenu à Paris du 6 au 11 février dernier, le secteur de la santé a été mis en avant et des appels à projets publics vont être lancés. L’accompagnement du déploiement de l’IA en France est un des grands sujets de la DGE. Comment articulez-vous votre action avec celle du ministère de la Santé et de ses opérateurs (DNS, AIS, ANS, Paris Santé Campus…)
T.C. : L’intelligence artificielle constitue une opportunité majeure pour le secteur de la santé, tant en termes d’innovation que de transformation des pratiques de soins. C’est pourquoi la DGE travaille en étroite collaboration avec l’Agence de l’innovation en santé (AIS), Paris Santé Campus, le ministère de la Santé et ses opérateurs, pour garantir une approche coordonnée et cohérente. Nous agissons sur deux volets : l’offre et la demande.
Du côté de l’offre, nous soutenons financièrement l’émergence de solutions innovantes. Par exemple, via des appels à projets comme le dispositif « Innovation en imagerie médicale », qui a permis de financer une vingtaine de projets et de structurer la filière via le financement de la recherche industrielle et du développement expérimental de dispositifs médicaux logiciels ou d’équipements. La majorité des projets financés intégrait de l’intelligence artificielle.
Du côté de la demande, nous accompagnons les entreprises et les professionnels de santé pour favoriser l’adoption concrète de ces technologies, en veillant à leur pertinence et à leur adaptation aux réalités du terrain. Nous avons pour cela recensé 111 cas d’usages « résolus » par l’IA, dont les entreprises et leurs « accompagnants de proximité » (chambres consulaires, réseaux d’entrepreneurs, conseils…) peuvent se saisir.
L’apport spécifique de la DGE réside notamment dans notre capacité à lier les dynamiques économiques et les enjeux de santé publique. Ce rôle est essentiel pour garantir un déploiement rapide, sécurisé et utile des solutions d’IA en santé. L’IA en santé nécessite une coordination fine entre nos priorités économiques et les défis de santé publique. C’est dans cette optique que nous travaillons collectivement.
Le plan national « Osez l’IA », lancé le 1er juillet, va d’ailleurs renforcer le travail que nous réalisons avec le secteur de la santé. Ce plan vise à accélérer la diffusion de l’intelligence artificielle (IA) dans toutes les entreprises françaises, en particulier dans les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Le rôle de la DGE est de participer à l’action publique afin de faire de l’IA un outil accessible, concret et utile pour toutes les entreprises françaises, où qu’elles se trouvent, quel que soit leur secteur, d’ici à 2030.
L’apport spécifique de la DGE réside notamment dans notre capacité à lier les dynamiques économiques et les enjeux de santé publique.
Les acteurs économiques de la santé présents en France sont de natures très différentes, mais participent tous à la bonne prise en charge de nos concitoyens et impactent le niveau de santé publique de notre pays. Cela influe-t-il sur la façon dont vous travaillez avec les professionnels de santé libéraux, les PME du dispositif médical, les cliniques et groupes de cliniques, ou encore les laboratoires internationaux et/ou leurs filiales françaises ?
T.C. : La diversité des acteurs du système de santé fait sa force et sa résilience : professionnels de santé libéraux, PME innovantes, laboratoires, groupements, plateformes numériques… appellent une approche différenciée mais cohérente, à la croisée des enjeux économiques, sanitaires et territoriaux. Les équipes de la DGE se rendent régulièrement sur le terrain pour bien appréhender les réalités opérationnelles et identifier les innovations portées par chacun.
S’agissant des industriels de santé, par exemple, une place particulièrement importante est laissée à la concertation et à la co-construction, avec une conciliation complexe entre enjeux sanitaires, budgétaires et industriels. La politique tarifaire repose d’ailleurs sur une base conventionnelle : industriels et CEPS cosignent l’accord-cadre qui a ensuite pour vocation de faciliter les négociations en donnant de la transparence et de la prévisibilité sur les critères de détermination des prix.
Les acteurs industriels sont activement associés à nos réflexions en matière de politique industrielle de santé. Récemment, les entreprises françaises ont notamment été impliquées dans le cadre des travaux menés autour de l’Alliance pour les médicaments critiques, de structuration de la politique de soutien européenne, pour lesquels la France a joué un rôle moteur.
Nous mobilisons aussi des leviers réglementaires (par exemple, clarification du cadre de la téléconsultation), de simplification (par exemple, faciliter l’accès au marché pour les innovations technologiques et organisationnelles, en complément des expérimentations menées dans le cadre de l’article 51 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018, réflexions sur la soutenabilité des modèles) et d’accompagnement et de mise en visibilité des innovations (par exemple, identifier et proposer de répliquer des initiatives d’une région, d’un département, d’une ARS ; mise en visibilité des solutions éprouvées d’IA pour la santé¹, programmes Next40/FT120 et FT2030 de la French Tech pour les start-ups).
Cette démarche nous permet, en lien avec le ministère de la Santé, de faire évoluer les politiques publiques au plus près des besoins concrets du secteur et de favoriser une transformation pragmatique et partagée du système de santé.
¹ https://www.entreprises.gouv.fr/la-dge/actualites/ami-ai-efficiency-les-laureats-en-detail
🔎 Lire la première partie de l’interview de Thomas Courbe