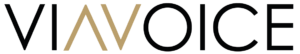Présidente de l’Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF), Caroline Combot alerte sur la place trop marginale accordée à sa profession dans les débats sur le PLFSS 2026, le « réarmement démographique » et l’organisation territoriale des soins. Pour La Veille Acteurs de santé, elle détaille ce que les sages-femmes apportent – et pourraient davantage apporter – au système de santé et à la santé des femmes, à condition d’être enfin reconnues comme une profession médicale à part entière.
Propos recueillis par Renaud Degas
Dans le débat qui s’ouvre sur le PLFSS 2026, où situez-vous les sages-femmes ?
Caroline Combot – Nous n’avons qu’une visibilité très restreinte dans ce budget de la Sécurité sociale. Celui-ci reste focalisé sur la prise en charge des maladies, avec des contraintes budgétaires énormes, et beaucoup moins sur la prévention. Or notre cœur de métier, c’est précisément la prévention autour de la grossesse, de la santé des femmes et des nouveau-nés. Nous avons porté une proposition de loi et un livre blanc sur la santé des femmes ; quelques mesures ont avancé, mais sur la vision globale – accompagnement dès les origines de la vie, santé périnatale, santé sexuelle et reproductive – on n’y est pas. Nous présentons chaque année des initiatives dans le même esprit, pour rappeler l’importance d’un accompagnement précoce et global.
Le Président de la République a parlé de « réarmement démographique ». Il serait logique que vous soyez en première ligne sur le sujet. Qu’en est-il ?
C.C. – Jusqu’à présent, aucune mesure concrète ne valorise vraiment le rôle des sages-femmes. À l’époque où Catherine Vautrin avait la charge du volet santé, elle a eu raison de s’attaquer en priorité aux modes de garde et à l’accueil des jeunes enfants. Mais on ne traite pas la question essentielle : pourquoi les couples font moins d’enfants. Là, les sages-femmes ont un rôle majeur : l’information, la pédagogie sur le corps, la fertilité, la contraception. On voit des femmes qui découvrent leur cycle à 38 ans après 20 ans de pilule… Rien que cette réappropriation du corps peut aider des couples à concrétiser leur projet d’enfant. Mais nos actions d’« aller vers », dans les écoles, auprès des publics fragiles ou en situation de handicap, restent très peu valorisées.
Et la baisse de la natalité change profondément votre paysage d’exercice…
C.C. – Oui, et parfois de façon violente. La baisse du nombre de naissances se traduit par moins d’activité dans les maternités, ce qui entraîne des fermetures de lits et des suppressions de postes de sages-femmes. Les décrets de périnatalité datent de 1998 ; de nouveaux ratios ont été proposés en 2019 mais jamais appliqués faute de moyens humains. Aujourd’hui, nous avons – pour une fois – le nombre de professionnelles pour les mettre en œuvre… mais la priorité est de réaliser des économies, pas d’investir. Résultat : des jeunes diplômées ne trouvent plus de postes à l’hôpital et basculent massivement en libéral, pendant que les maternités privées ferment les unes après les autres et que la PMI reste le parent pauvre.
« Une femme peut consulter une sage-femme en accès direct à tout moment de sa vie. »
Concrètement, jusqu’où peuvent aller aujourd’hui les compétences des sages-femmes auprès des femmes ?
C.C. – Une femme peut consulter une sage-femme en accès direct à tout moment de sa vie. Nous assurons le suivi gynécologique de prévention depuis 2009 : contraception, dépistages, frottis, vaccination, santé sexuelle… Compétence encore trop méconnue, mais qui explose car les cabinets de gynécologues ferment.
En périnatalité, nous accompagnons la grossesse, la naissance et le post-partum, en ville comme à l’hôpital. Nous intervenons aussi en assistance médicale à la procréation, en IVG, en éducation à la vie affective et sexuelle.
Et nous pourrions aller plus loin sur la ménopause, les fausses couches spontanées, certains arrêts de travail et une liste de prescriptions adaptée à la réalité de nos pratiques. Ce ne sont pas de « nouveaux » champs : historiquement, les sages-femmes se sont toujours occupées de la santé des femmes, bien au-delà de la seule naissance. Ce sont en fait des champs de compétences que nous nous réapproprions petit à petit.
Vous insistez beaucoup sur votre rôle de prévention. Qu’est-ce que cela change pour le système de santé ?
C.C. – Une grossesse, c’est au minimum un an de suivi, avec des rendez-vous mensuels. Ce temps long permet d’anticiper énormément de complications. Les équipes qui font de l’accompagnement global à la naissance observent moins de prématurité et moins de complications, parce qu’elles sont dans la prévention maximale et la continuité du lien.
En ville, notre maillage est très bon : les travaux de la CNAM montrent que les sages-femmes sont l’une des professions les mieux réparties sur le territoire. Si l’on organise le système autour de plateaux techniques hospitaliers pour les situations complexes, et d’un suivi majoritairement en ville par les sages-femmes, on peut à la fois améliorer la qualité des parcours et maîtriser les coûts.
Pourtant, vous dénoncez un statut hospitalier qui vous met « en sous-profession médicale ». De quoi s’agit-il ?
C.C. – Selon le Code de la santé publique, nous sommes une profession médicale, au même rang que les médecins et les chirurgiens-dentistes. Mais à l’hôpital, nous sommes fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, avec deux jours et demi de formation continue par an, contre quinze pour les médecins. Nous n’avons pas non plus accès au statut hospitalo-universitaire, ce qui bloque la recherche en maïeutique. Enfin, nous ne pouvons pas combiner librement activité hospitalière et libérale comme le font les médecins et les chirurgiens-dentistes : pour exercer un peu en libéral, une sage-femme doit prendre une disponibilité de plusieurs années, puis choisir définitivement. Cette situation freine la mobilité, l’exercice mixte ville/hôpital et l’adaptation aux besoins des territoires.
Qu’est-ce qui bloque la sortie de ce statut ?
C.C. – Longtemps, on nous a opposé le désaccord entre syndicats de sages-femmes, puis l’opposition des grandes centrales syndicales de la fonction publique, qui refusaient par principe une sortie de la FPH, sans vraiment écouter les sages-femmes.
Mais aujourd’hui, la profession est alignée : nous voulons un cadre d’emploi médical, avec une grille spécifique si nécessaire. Nous ne demandons pas d’être payées comme des médecins, nous demandons de pouvoir travailler comme une profession médicale moderne, mobile, formée, avec la possibilité d’un exercice mixte, et de respecter pleinement notre code de déontologie. C’est, à mes yeux, le nœud du problème : tant que ce verrou ne sautera pas, on bricolera.
« Nous demandons de pouvoir travailler comme une profession médicale moderne, mobile, formée, en exercice mixte, et de respecter notre code de déontologie. »
Comment se passent vos relations avec les autres professions de santé sur le terrain ?
C.C. – Très bien, globalement. Nous travaillons en permanence avec les médecins, les infirmiers, les puéricultrices, les kinés, les pharmaciens, les ergothérapeutes… Dans les faits, nous sommes un vrai couteau suisse des maternités et des parcours périnataux. Là où les choses se compliquent, c’est quand la régulation vient mettre tout le monde en concurrence pour se partager le “gâteau” de l’activité, par exemple autour de la naissance ou des soins non programmés. On parle beaucoup de structures – CPTS, maisons de santé, Maisons France Santé – mais trop peu de confiance accordée aux professionnels eux-mêmes et de financement direct de leurs missions de coordination. On pourrait faire beaucoup plus simple, moins coûteux et beaucoup plus efficace.
Si vous aviez un message à adresser aux parlementaires qui travailleront sur le PLFSS 2026, quel serait-il ?
C.C. – D’abord : regardez la prévention en face. Investir dans la santé des femmes, la périnatalité, le post-partum, ce n’est pas un « plus » facultatif, c’est préparer un avenir où la population est en meilleure santé. Ensuite : faites confiance aux sages-femmes. Nous sommes 24 000, bien réparties sur le territoire, avec une culture interprofessionnelle forte et une expertise unique de la santé des femmes et des nouveau-nés. Donnez-nous un statut cohérent, des compétences alignées avec nos pratiques et les moyens de jouer pleinement notre rôle : nous serons un levier puissant pour désengorger l’hôpital, renforcer l’accès aux soins et, peut-être, redonner envie aux Françaises et aux Français d’avoir des enfants.