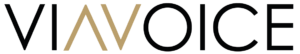La télémédecine, longtemps perçue comme une solution d’appoint, s’impose aujourd’hui comme un levier stratégique pour améliorer l’accès aux soins. C’est le constat partagé par les experts réunis lors du débat « La télémédecine a-t-elle vraiment un avenir en France ? », diffusé le 1er octobre dans le cadre des Contrepoints de la santé. Une émission qui a réuni des représentants des institutions, du terrain et du monde de l’innovation pour dresser un état des lieux en écho aux assises de la télémédecine actuellement en cours. Synthèse.
A voir…
… ou à écouter
///
La télémédecine : un outil intégré au projet médical global
Sur le plateau, Mickaël Benzaqui, sous-directeur de l’accès aux soins et du premier recours à la Direction générale de l’offre de soins (DGOS), a rappelé que la télémédecine devait être pensée comme un outil au service d’un projet médical global, et non comme une fin en soi. Elle offre des réponses concrètes aux inégalités territoriales, à condition d’être intégrée dans des parcours coordonnés et encadrés. Mais, au regard de son développement dans d’autres pays d’Europe, il reste du chemin à parcourir.
Un financement à clarifier pour lever les freins
Albert Lautman, directeur général de la CPAM de l’Essonne et en charge des Assises de la télémédecine, a, lui, souligné entre autres l’importance d’un cadre de financement clair et durable. Les Assises de la télémédecine, a-t-il précisé, sont destinées à proposer des ajustements des règles du jeu et à lever les freins à la pratique, notamment rediscuter du plafond de 20 % d’activité des médecins en téléconsultation, jugé aujourd’hui par beaucoup trop restrictif.
Il a également évoqué l’importance de progresser dans l’articulation entre professionnels de santé de terrain et usage de la télémédecine, en particulier concernant la téléconsultation. À la fois pour une intégration plus naturelle de la télémédecine dans la pratique des professionnels de santé et pour améliorer l’accès aux soins des populations en ayant le plus besoin, au-delà des « early adopters », plutôt jeunes et urbains.
L’expérience du terrain : faire évoluer les pratiques
Du côté des acteurs de terrain, Lucie Renault-Dietsché, de la plateforme Qare, et Ivo Trinta, du réseau Point Vision, ont partagé leur expérience de l’innovation médicale au quotidien. Tous deux ont insisté sur la nécessité de faire évoluer les organisations et de renforcer la coopération entre professionnels pour garantir la qualité des soins à distance. Ils ont aussi souligné les restrictions réglementaires et financières qui subsistent en France et qui freinent le développement de la télémédecine.
Mickaël Benzaqui a souligné que tous les acteurs de la télémédecine étaient utiles et importants pour le développement de la télémédecine et que, contrairement à certaines idées reçues, les chiffres d’usage montrent que les plateformes privées de téléconsultation sont utilisées par des populations fragiles.
Une exigence d’inclusion et de confiance numérique
Enfin, Majid El Jarroudi, membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et co-rapporteur de l’avis publié en juin 2025 intitulé « Pour un numérique en santé souverain, de confiance et inclusif », a apporté une lecture plus sociétale, rappelant que la télémédecine devait rester inclusive, accessible aux plus vulnérables et articulée avec les réalités locales.
Il faut, en tout cas, se préoccuper sérieusement des 14 millions de Français en situation d’illectronisme qui ne sont pas à l’aise dans l’utilisation des outils numériques, pour éviter une nouvelle inégalité, numérique cette fois-ci.
Un consensus : la télémédecine comme prolongement intelligent du soin
L’émission, enrichie par l’analyse du politiste Adrien Broche (Viavoice), a mis en lumière un consensus : la télémédecine ne peut pas se substituer à la relation humaine entre patients et professionnels de santé, mais elle peut en être le prolongement intelligent qui augmente et optimise l’offre de soins. À condition d’une gouvernance partagée, d’une coordination fluide entre tous les acteurs, d’une organisation pragmatique renforcée et d’une évaluation continue de son impact.