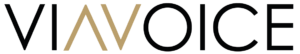Le secteur de la santé est dépendant de l’eau à chaque étape : soins, hygiène, équipements, chaîne du froid, médicaments, nettoyage, refroidissement des data centers… Il est donc, de fait, particulièrement exposé à la crise de l’eau.
Par Olivier Toma – expert RSE et santé environnementale
Prenons les maternités. L’eau est omniprésente : dans les salles de naissance, pour la préparation des biberons, pour le nettoyage des instruments, pour l’entretien du linge, les sanitaires, les douches. Cette eau, une fois utilisée, devient un effluent. Un rejet liquide souvent chargé en résidus médicamenteux ou chimiques, qui alourdit le bilan écologique de l’établissement.
Les stations d’épuration ne sont pas conçues pour traiter ces résidus. On retrouve ainsi aujourd’hui dans les cours d’eau français des traces de substances médicamenteuses. Des concentrations maximales « de l’ordre de 400 ng/L en eaux brutes (paracétamol) et de l’ordre de 100 ng/L en eaux traitées (acide salicylique) », révèle un rapport dévoilé en 2011 par l’Anses, à l’issue d’une « campagne nationale d’occurrence des résidus de médicaments dans les eaux destinées à la consommation humaine ». Des études actuellement menées par le Conseil Scientifique des Iles de Lérins (CSIL) sont également en train de démontrer que le milieu naturel marin n’est pas épargné.
Des consommations d’eau colossales
Mais ce n’est pas tout : les piscines de rééducation, les installations de dialyse, les laboratoires, les climatiseurs, les stérilisateurs… sont autant de systèmes qui mobilisent des volumes colossaux d’eau, sans que cela ne soit comptabilisé ou interrogé.
Et que dire de l’empreinte hydrique des médicaments ? De leur fabrication à leur distribution, en passant par leur emballage, chaque étape mobilise de l’eau, bien au-delà de ce que l’on imagine.
La santé, parce qu’elle est vitale, devrait se donner comme objectif d’être exemplaire dans sa gestion de l’eau. Mais cela suppose de commencer par mesurer, mais aussi d’innover, de former et de changer ses pratiques. L’empreinte hydrique dans ce secteur n’est pas une option : c’est une nécessité stratégique, éthique et opérationnelle.
Parlons peu, parlons chiffres
Mesurer son empreinte hydrique ? C’est désormais possible, au même titre que d’évaluer son empreinte carbone. Primum Non Nocere a effet conçu un outil permettant aux établissements, entreprises et autres organisations de quantifier la quantité d’eau qu’ils utilisent. Le CH de Cannes en a fait l’expérience et en a, la semaine dernière, dévoilé les résultats.
En savoir plus sur l’empreinte hydrique, un outil développé par l’agence Primum non nocere
Cliquez ici
Le secteur textile, nouveau modèle ?
Evidemment, le secteur de la santé n’est pas le seul à être gourmand en eau. On le sait, le secteur de la mode est particulièrement concerné. Selon des estimations, la fabrication d’un seul t-shirt en coton nécessite 2 700 litres d’eau douce, soit ce qu’une personne boit en 2,5 ans, rappelle le Parlement européen sur son site. Sans compter que la production textile serait responsable d’environ 20 % de la pollution mondiale d’eau potable, à cause des teintures et autres produits de finition auxquels elle fait appel, et qu’elle mobilise des terres pour cultiver le coton et d’autres fibres.
Mais le saviez-vous ? À partir du 1er octobre, en France, les vêtements afficheront leur « coût environnemental ». Un chiffre simple, calculé sur tout le cycle de vie : matières premières, fabrication, transport, usage, fin de vie… et même la durabilité. Fini les belles promesses : toutes les marques devront utiliser le même outil public Ecobalyse. Résultat : une base commune, transparente, enfin comparable.
Est-ce parfait ? Non. Mais c’est un pas décisif.
Car si chacun d’entre nous choisit le vêtement au score le plus sobre, l’impact est réel. Individuellement, quelques kilos de CO₂ et des dizaines de litres d’eau évités. Collectivement, des tonnes de CO₂ et des milliers de litres d’eau économisés si 1000 personnes s’y engagent.
Le secteur de la santé peut-il être à la traîne de ces évolutions et de cette prise en compte de cet enjeu vital ?