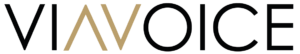Transformer un établissement de santé en lieu de vie, de lien… et de soin : telle est la promesse de l’art. Le 21 juillet 2025, une nouvelle convention nationale « Culture et Santé » a été signée entre les ministères de la Santé et de la Culture. Peu médiatisée, elle marque pourtant un tournant majeur : l’accès à la culture devient un droit fondamental pour tous les patients, résidents et professionnels des établissements de santé.
Aujourd’hui, plus de mille projets artistiques voient déjà le jour chaque année dans les hôpitaux, EHPAD ou centres médico-sociaux… et ce n’est qu’un début. Cette dynamique s’accompagne d’outils concrets pour rendre la culture pleinement inclusive. Le ministère de la Culture a ainsi publié un guide intitulé « Une culture accessible à toutes et tous », destiné à faciliter l’accès aux activités artistiques pour les personnes présentant des troubles du neurodéveloppement (TND) – TSA, DYS, TDAH… Le guide recense les bonnes pratiques d’accueil, d’accompagnement et d’adaptation, soulignant la responsabilité nouvelle des établissements : soigner non seulement le corps et l’esprit, mais aussi l’environnement relationnel et culturel du soin.
L’art, un levier de soin reconnu
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) confirme que l’art est plus qu’un simple embellissement : c’est un véritable levier d’amélioration de la santé physique et mentale. Son rapport, basé sur l’analyse de plus de 900 publications scientifiques, documente des effets tangibles : réduction du stress, de l’angoisse et de la douleur, amélioration du sommeil, de l’humeur et de la concentration. L’art agit comme un « soin invisible », mais puissant. La musique, la danse, le théâtre ou les arts plastiques ne se limitent pas à distraire : ils structurent le quotidien, stimulent les fonctions cognitives, favorisent l’expression des émotions et renforcent le sentiment de dignité.
Les études montrent aussi que l’art agit sur le corps : l’expression artistique peut réduire la perception de la douleur, moduler la tension artérielle et diminuer les symptômes d’anxiété et de dépression. Ces bénéfices ne concernent pas seulement les patients : les soignants eux-mêmes, exposés au stress et à la charge émotionnelle, peuvent trouver dans l’art un outil de prévention du burn-out et de renforcement de la résilience.
L’œil d’Olivier Toma
« Intégrer l’art dans les soins ne relève pas du luxe : c’est un levier stratégique pour le bien-être au travail, l’inclusion des patients et l’amélioration de l’accueil. L’art contribue à lutter contre l’isolement, stimule la qualité du lien humain et soutient la démarche THQSE (Très Haute Qualité Sanitaire, Sociale et Environnementale) désormais adoptée par plus de 1 000 établissements en France. Le lien avec la RSE est direct : l’art améliore la qualité de vie au travail, renforce la santé mentale des équipes et enrichit la relation avec les patients. » Olivier Toma, fondateur de Primum non nocere
Des recommandations concrètes pour l’inclusion
Le guide « Une culture accessible à toutes et tous » propose neuf fiches pratiques, déjà adoptées dans plusieurs établissements :
- adapter l’environnement sensoriel avec des éclairages doux, un niveau sonore maîtrisé et des couleurs apaisantes ;
- offrir un accueil rassurant, avec des repères visuels et un rythme prévisible ;
- privilégier des activités participatives basées sur le rythme et le choix de chacun, sans injonction à produire ;
- former les intervenants à une approche inclusive, centrée sur la compréhension plutôt que le jugement.
Ces recommandations permettent de rendre la culture accessible à tous et de renforcer le rôle de l’art comme soin complémentaire.
Ressources
- Le guide « Une culture accessible à toutes et tous » est le fruit d’une collaboration interministérielle entre le ministère de la Culture et la Délégation interministérielle à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement (TND).
- Le rapport de l’OMS sur l’art et la culture