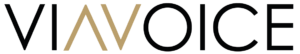Avec l’omniprésence des réseaux et des plateformes numériques, une grande partie de l’information circule en ligne souvent déformée, simplifiée ou sortie de son contexte. Cette transformation nourrit une défiance croissante du public face à la fiabilité des messages en santé. Aujourd’hui, 66 % des Français estiment que le domaine médical est particulièrement exposé aux fake news. Ce constat soulève une question cruciale : comment garantir une information fiable, claire et accessible ? [1] Analyse.
DESINFORMATION MEDICALE : UN GRAND IMPACT
Les fausses informations ne datent pas d’hier. Mais elles explosent à chaque crise. Durant la crise Covid, la désinformation a pris une ampleur inédite, au moment même où la science avançait à grands pas.
Un paradoxe que souligne Pascal Maurel, co-Président de l’UC2m et l’animateur de ce symposium organisé lors du congrès des IFODS : « la science n’a jamais été aussi performante, et pourtant, la désinformation prospère ». Il rappelle aussi qu’un État peut, lui-même, jouer un rôle actif dans la diffusion de messages trompeurs, citant les États-Unis et leur communication scientifique actuelle, particulièrement controversée.
LA VIRALITE PRIME SUR LA VERITE
La désinformation en santé fragilise la confiance entre citoyens et professionnels. Elle sème le doute, nourrit la peur et brouille les repères. Pourtant, elle émane d’une minorité, selon Roman Bornstein, directeur des Etudes de la Fondation Jean-Jaurès. En effet, 0,01 % des internautes sont responsables de 80 % des fausses informations en ligne. Pendant la présidentielle américaine de 2016 et sur les vaccins, quelques comptes très actifs ont massivement diffusé des fake news.
Pourquoi cette minorité pèse-t-elle autant ? L’analyste identifie trois sources : les réseaux sociaux, les médias professionnels et les médias personnels. Mais ce sont surtout les premiers qui amplifient la désinformation via des algorithmes favorisant des contenus souvent anxiogènes ou colériques. Résultat : la viralité prime sur la vérité.
Dans ce contexte, les voix des experts peinent à se faire entendre et le public se perd dans un brouillard d’informations contradictoires. Sa conclusion est la suivante : « tant qu’il n’y aura pas un matraquage règlementaire et fiscal sur les grandes plateformes étrangères qui autorisent un flux continu de contenus nocifs pour la santé publique, il n’y aura jamais de solution », poursuit Roman Bornstein.
UN DEFI COLLECTIF POUR LUTTER CONTRE LA DESINFORMATION
Pour lutter contre la désinformation, la députée et médecin Stéphanie Rist insiste sur l’action contre les grandes plateformes numériques, proposant une taxation de 2 % de leur chiffre d’affaires pour financer la prise en charge des effets sanitaires liés aux troubles alimentaires. Une résolution européenne en ce sens a été récemment proposée, « une proposition de résolution certes symbolique, mais qui montre l’engagement de l’Assemblée au niveau européen », souligne la députée.
Elle préconise aussi de former, aider et labelliser des influenceurs de confiance sur les réseaux sociaux pour qu’ils deviennent des interlocuteurs crédibles de l’information en santé.
Jean-François Delfraissy, le Président du Comité consultatif national d’éthique, plus optimiste, rappelle que la confiance dans la science reste forte, mais elle doit s’appuyer sur une parole visible. Il appelle à des réponses nationales si l’Europe tarde à agir, tout en soulignant la nécessité de conserver des canaux d’information diversifiés car certains jeunes reviennent aux médias classiques.
« TROP D’INFORMATION TUE L’INFORMATION »
Pour Jean Lessi, le directeur général de la Haute Autorité de Santé (HAS), la vérité est souvent noyée dans des contenus trop nombreux. Pour contrer cela, il faut utiliser les codes de la viralité, des formats courts, des témoignages concrets, tout en appliquant strictement la régulation des données.
L’information doit surtout encourager à agir en ciblant prioritairement les publics hésitants avec des messages clairs portés par des témoins expérimentés.
Quant à Nicolas Scotté, le directeur général de l’Institut national du cancer (INCa), il insiste sur la continuité d’action pour transmettre des messages de santé publique essentiels en cancérologie. Il précise la nécessité d’une information fiable, accessible via des sites reconnus comme « cancer.fr ». Le dirigeant fait également remarquer qu’il faut réduire l’écart entre connaissance et action et qu’il faut diversifier les canaux en privilégiant l’approche « pair à pair » et les codes des réseaux sociaux.
LES DEFIS DE L’INFORMATION : MIEUX INFORMER POUR MIEUX SOIGNER
La conférence a voulu comprendre comment les professionnels de santé s’emparent de ces enjeux informationnels. L’objectif : analyser leurs actions concrètes face à la complexité médicale, la désinformation et les attentes évolutives des patients.
L’intervention de Fabrice Barlesi, le directeur général de l’Institut Gustave-Roussy, a illustré avec force ce que signifie prendre la parole face à une actualité médicale qui frappe fort. Il revient sur une réalité qui est l’augmentation préoccupante des cancers chez les jeunes adultes présentée en janvier 2025 en conférence de presse. En quelques jours, une donnée clinique est devenue un fait médiatique, provoquant émotion et inquiétude. Le choc a été immédiat et l’information devient virale rapidement.
Face à la diffusion massive d’un constat aussi inquiétant, la communication bascule dans l’urgence.
Fabrice Barlesi le rappelle, cette évolution n’est pas nouvelle dans les services hospitaliers. Depuis plusieurs années, les soignants constatent des cancers chez des trentenaires. Mais jusqu’ici, le phénomène restait peu exposé. Or, entre 1990 et 2020, l’incidence des cancers chez les moins de 40 ans a augmenté de 80 %, et les décès de 30 %. Cette variation préoccupe et soulève des questions.
« Ce sont des patients en pleine vie active, avec des enjeux personnels, sociaux et professionnels majeurs. Le retentissement est considérable », souligne le directeur. Ce ne sont pas seulement les données épidémiologiques qui frappent mais les conséquences concrètes : des parcours de soins plus tardifs (car les symptômes sont souvent jugés bénins), des traitements dont les effets durent des décennies, des questionnements sur la fertilité ou la réinsertion professionnelle.
Sur le plan biologique, les différences sont minimes entre un cancer du côlon chez un jeune ou chez une personne âgée. Mais le contexte de la maladie change : équilibre hormonal, retentissement psychologique, environnement de vie. Des facteurs environnementaux comme les pesticides, la pollution, l’alimentation ou bien la sédentarité sont aujourd’hui étudiés de près dans le concept d’exposome. Une étude récente dans Nature Medicine tente d’évaluer leur poids dans ces cancers dits précoces. Pour y répondre, Gustave-Roussy a lancé un programme international, ciblant plus de 5000 patients de moins de 40 ans. L’enjeu est multiple. Il faut comprendre, prévenir, adapter les traitements et guérir. Mais pour le directeur, une vérité demeure : « il faut avoir à l’esprit qu’on ne connait pas tout ».
LES PATIENTS SONT ACTEURS DE LEUR SANTE
Une question se pose : comment les grandes institutions s’adaptent-elles aux bouleversements informationnels actuels ?
Pour Isabelle Jourdan, la directrice de la communication de l’AP-HP, le rôle des établissements publics est de ne pas déserter les canaux numériques, au risque de laisser le champ libre à la désinformation.
« Les réseaux sociaux ne sont pas une fatalité. On peut agir », résume-t-elle.
L’AP-HP investit ainsi ses moyens institutionnels par un site internet accessible, des contenus pédagogiques, des partenariats avec des influenceurs mais aussi des vidéos sur YouTube. L’information doit être visible là où les patients la cherchent. « Si ceux qui ont le savoir ne prennent pas la parole, d’autres le feront à leur place ».
Lors de l’extension de l’obligation vaccinale pour les enfants, l’AP-HP a mené des analyses qualitatives pour comprendre les freins. Ce n’était pas un rejet idéologique mais une méconnaissance du mécanisme vaccinal. La réponse a été ciblée. Une collaboration avec des influenceurs proches du public visé, un langage accessible et des formats adaptés ont été mis en place. En résulte une meilleure compréhension et une confiance restaurée. Pour la responsable de la communication, l’enjeu n’est plus seulement d’informer, mais d’échanger. Car aujourd’hui, « les patients sont acteurs de leur santé ».
RECONQUERIR
À Nice, Emmanuel Barranger, à la tête du Centre Lacassagne, est convaincu que tout commence par la transparence. « La confiance passe par une information claire, lisible, compréhensible et ce, dès l’annonce du diagnostic ». Il distingue deux temps : informer pour prévenir la maladie puis informer pour accompagner la prise en charge. Dans les deux cas, l’abondance de sources (HAS, INCa, Assurance maladie, médias, réseaux sociaux…) peut brouiller les repères. Mais les professionnels de santé gardent une crédibilité forte. « Encore faut-il s’en saisir », souligne le dirigeant médecin.
Selon lui, si les réseaux sociaux se sont imposés, c’est aussi parce que les institutions leur ont cédé du terrain. Il appelle à une reconquête de cet espace et à une exigence accrue de pédagogie. « Informer, ce n’est pas juste dire. C’est accompagner. Donner forme à l’esprit. Et ça, c’est un apprentissage ». Dans un monde saturé d’informations, une communication de qualité reste un véritable outil thérapeutique.
« Le chantier est ouvert », concluent Pascal Maurel et Jean-Philippe Spano, Président des IFODS.
Jade Pronost
[1] D’après la conférence « la bonne information en Santé », congrès des IFODS (Journées Franco-Internationales d’Oncologie), 12 juin 2025