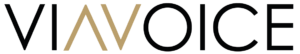Pour La Veille Acteurs de santé, Thomas Courbe, le Directeur général des entreprises (DGE), revient longuement sur l’action de sa direction dans le secteur de la santé. Dans cette première partie de l’interview, il détaille l’objectif de l’État : combiner politique de décarbonation et relocalisation des industries de santé.
La DGE est aujourd’hui impliquée dans de nombreux sujets de santé. Est-ce nouveau ou simplement plus visible ? Comment coordonnez-vous le travail de vos équipes et vos actions avec celles du ministère de la Santé ?
Thomas Courbe. La DGE a toujours été impliquée sur les sujets de santé, mais la prise de conscience de nos dépendances sanitaires pendant la crise du Covid a sans doute contribué à renforcer notre ambition dans ce domaine. Cette évolution s’est traduite par un engagement accru sur plusieurs fronts :
- la sécurisation de nos approvisionnements pour les médicaments critiques ;
- le soutien actif à la structuration et au développement des filières innovantes, en particulier les biotech et medtech ;
- ainsi que l’intégration des innovations numériques.
Le plan Innovation santé 2030, présenté en juin 2021 par le Président de la République et intégré dans France 2030, ou le projet important d’intérêt européen commun en santé – véritable politique industrielle commune au niveau européen – témoignent de cet engagement. In fine, l’objectif est double : réduire nos vulnérabilités stratégiques tout en positionnant la France comme un leader sur les innovations de rupture.
« Pour nous, les objectifs de transition écologique et de souveraineté sont donc liés et complémentaires. »
Pour mémoire, en début d’année 2025, vous avez fait le point sur les enjeux économiques de la France et de ses entreprises. Souveraineté et décarbonation sont deux axes importants à vos yeux. Les deux objectifs sont-ils compatibles ?
T.C. À l’occasion du 4e Conseil de planification écologique, le 31 mars dernier, le Président de la République et le Premier ministre ont réaffirmé l’importance de nos objectifs de planification écologique et leur cohérence avec l’ambition économique, industrielle et de souveraineté de la France.
Pour nous, les objectifs de transition écologique et de souveraineté sont donc liés et complémentaires. C’est pourquoi nous mobilisons un ensemble de leviers pour assurer la décarbonation des industries existantes, garantir la montée en puissance de l’électricité décarbonée et renforcer la production de biens essentiels au fonctionnement de la nation, comme les produits de santé.
Sur le plan national, les dispositifs de soutien financiers à la décarbonation des filières industrielles sont maintenus. Les moyens ont même été augmentés de 1,6 Md€ dans la loi de finances 2025, correspondant notamment au lancement de l’appel d’offres « Grands projets industriels de décarbonation », à destination des projets de plus de 20 M€ d’investissement. Au niveau européen, à travers la négociation du Pacte pour une industrie propre, nous cherchons également à favoriser l’investissement dans les marchés de la décarbonation et à renforcer la protection des acteurs européens contre la concurrence déloyale.
Et pour les entreprises et les industries du secteur de la santé, où la pression sur les prix est forte et va en s’accentuant, pensez-vous que ce double objectif soit tenable ? Quelles sont les voies de passage pour notre industrie de santé ?
T.C. : Dans le secteur de la santé, qui contribue fortement à l’empreinte carbone nationale, la souveraineté est d’autant plus liée à la transition écologique que les productions françaises de médicaments sont bien moins carbonées que celles de la concurrence, notamment asiatique, avec laquelle la moitié de l’écart de prix vient de la qualité environnementale.
Les relocalisations soutenues ces dernières années mettent en œuvre, par ailleurs, souvent des procédés innovants permettant d’allier compétitivité et diminution de l’empreinte environnementale. L’État et les filières collaborent dans ce contexte pour réussir la transition écologique de l’industrie tout en renforçant notre souveraineté industrielle, via la feuille de route de décarbonation du comité stratégique de filière et la planification écologique du système de santé, qui ont permis de déterminer des actions concrètes à réaliser pour accélérer cette transition.
Notre objectif, dans ce contexte, est d’accompagner les efforts de décarbonation des industriels et de permettre de les valoriser afin de créer un cadre plus attractif. Une mesure phare de la planification écologique du système de santé était ainsi la réalisation d’une méthodologie d’évaluation de l’empreinte carbone des médicaments. Cette méthodologie a été publiée en ce début d’année 2025. Elle doit permettre aux décideurs publics de disposer de données quantifiées en amont de l’élaboration de politiques publiques visant à favoriser l’orientation vers des médicaments plus décarbonés, permettre aux fabricants de mettre en œuvre des actions de décarbonation de leur outil industriel et de leur chaîne d’approvisionnement, et permettre aux acheteurs de médicaments d’intégrer cette méthodologie dans les critères d’évaluation des offres, afin de réaliser des achats durables1.
« Une mesure phare de la planification écologique du système de santé était ainsi la réalisation d’une méthodologie d’évaluation de l’empreinte carbone des médicaments. »
Notre dépendance aux produits de santé fabriqués hors d’Europe a éclaté au grand jour avec la crise du Covid. Vous l’avez évoquée, elle a donné lieu à des politiques publiques de réimplantation sur notre territoire et sur le territoire européen. Où en sommes-nous et quelles sont les perspectives dans un contexte à la fois de maîtrise des finances publiques et de tensions internationales ? Quels sont les leviers sur lesquels l’État peut continuer à agir pour favoriser cette « relocalisation » ?
T.C. : Depuis 2020, nous avons lancé des chantiers majeurs pour renforcer notre souveraineté sanitaire et industrielle, identifiant par exemple une liste de médicaments stratégiques sur les plans industriel et sanitaire, sur la base de laquelle le Président de la République a annoncé en juin 2023 le lancement d’un plan de relocalisation.
Ce plan a déjà permis de soutenir quarante-deux projets de renforcement de la chaîne de valeur pour des médicaments critiques, via les plans d’investissement France 2030 et France Relance. Ces projets, qui ont concerné un grand nombre d’aires thérapeutiques essentielles (comme l’anesthésie-réanimation ou les anticancéreux), vont par exemple permettre la relocalisation totale de la chaîne de production du paracétamol en France (avec les projets de Seqens et d’Ipsophène sur le principe actif, et le projet de Benta Lyon).
Cette dynamique nationale est maintenant prolongée par une forte dynamique européenne, dans laquelle la France est pleinement mobilisée, et qui s’incarne par la publication, en mars 2025, d’un Critical Medicines Act. Ce texte insiste sur la nécessité d’une action européenne coordonnée pour renforcer nos capacités de production de médicaments critiques, afin de limiter nos vulnérabilités et donc les tensions d’approvisionnement. Cette ambition d’autonomie stratégique, dans un contexte de forte dépendance à la Chine et à l’Inde, s’est vue encore renforcée à l’aune du contexte géopolitique actuel.
Les projets de relocalisation impliquent une action cohérente : ils doivent prioriser les médicaments stratégiques pour lesquels nous avons la plus grande vulnérabilité (sur les plans industriel et thérapeutique), en les soutenant par des investissements capacitaires ciblés, et par des mesures permettant de pérenniser les modèles économiques fondés sur une production en Europe. Cela passe notamment par la simplification du cadre réglementaire applicable à ces produits critiques, ainsi que par une meilleure valorisation – notamment dans la commande publique – de la sécurité d’approvisionnement qu’ils confèrent, ainsi que de la qualité environnementale de leur production.
1 – Méthodologie d’évaluation de l’empreinte carbone des médicaments